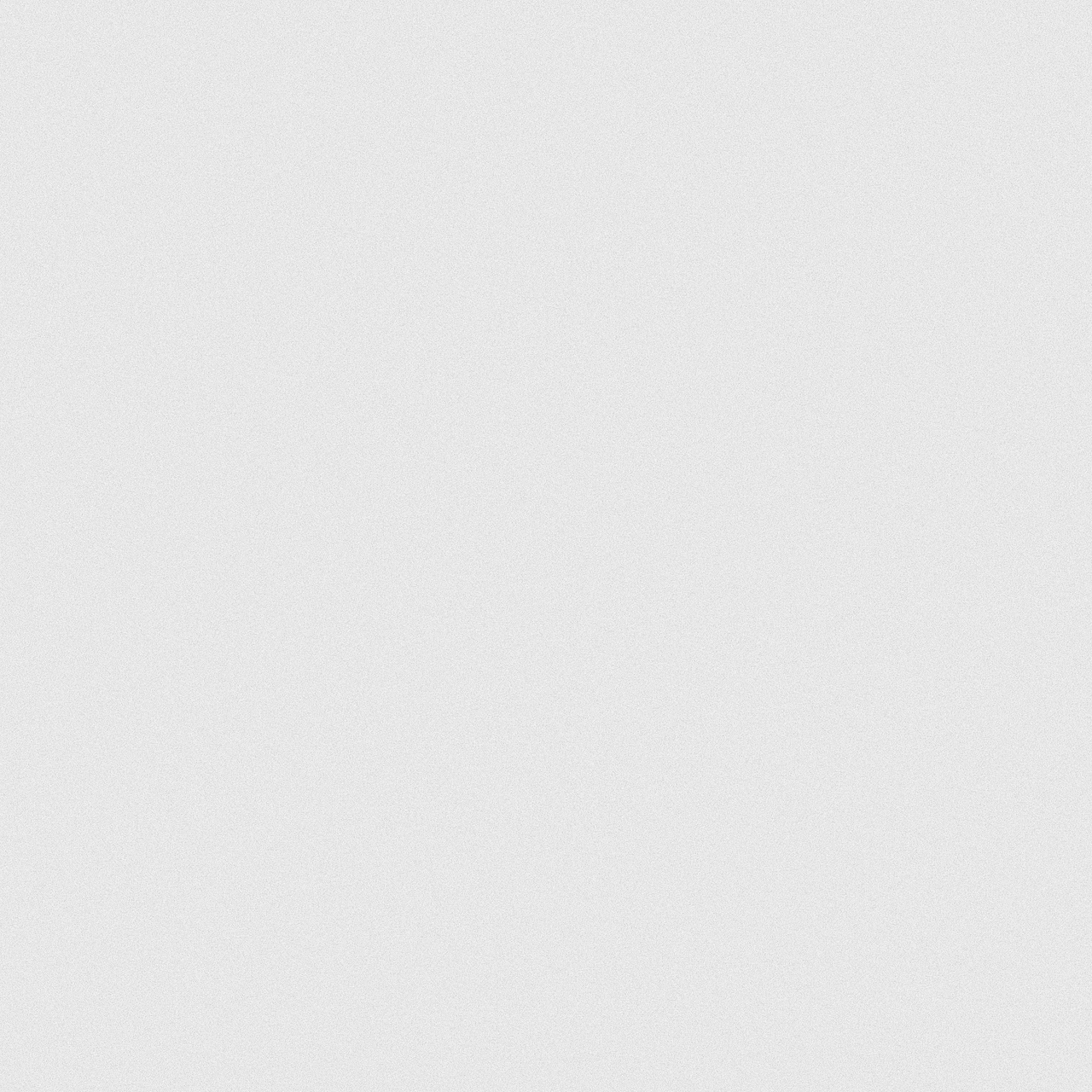
Le 16 mars 2017 : connaissez-vous Jacques de Liniers. allez sur le net et vous ferez connaissance avec lui:
Vénéré en Espagne, inconnu en France, Jacques de Liniers
Publié le 24 septembre 2018
Fulgence BIENVENÜE.
Père du métro parisien
Publié par le Télégramme, le 25 juin 2017 à 14h00
par ERWAN CHARTIER-LE FLOC'H
Originaire d’Uzel, dans les Côtes-d’Armor, Fulgence BIENVENÜE a suivi une brillante carrière d’ingénieur avant d’être chargé de la construction des premières lignes du métropolitain parisien, particulièrement la Ligne 1, construite pour l’exposition universelle de 1900.
C’est à Uzel, petite commune des Côtes-du-Nord, entre Saint-Brieuc, Quintin et Loudéac, que voit le jour Fulgence BIENVENÜE, en janvier 1852. Il naît dans une famille de treize enfants, bien implantée dans la région. Notaire, son père se passionne pour l’histoire et l’archéologie locale, tout en inculquant à son fils, le goût des auteurs grecs et latins. Son grand-père, Louis-René BIENVENÜE avait été nommé représentant à la Chambre des Cent-Jours pour le retour de Napoléon, ce qui vaudra quelques représailles à ce magistrat, écrivain et polémiste, après la restauration des Bourbons.
Ingénieur brillant
Élève brillant, Fulgence obtient le baccalauréat de philosophie à 15 ans, puis part à Paris pour devenir ingénieur. Admis à Polytechnique en 1870, il est mis à disposition du gouvernement pour diffuser des messages. Arrêté par les Communards, il échappe de peu à une exécution sommaire. Il intègre ensuite l’école des Ponts-et-Chaussées avec son compatriote Harel de la NOË qui bâtira le réseau secondaire des trains des Côtes-du-Nord.
Il se rend ensuite dans l’Orne, malgré son souhait de revenir en Bretagne. Il se distingue dans la mise en place des lignes de chemins de fer locaux, notamment entre Fougères et Vire. Il a volontiers recours aux nouveaux moyens technologiques pour les travaux publics, comme l’usage de la dynamite. Mais le 25 février 1881, il perd son bras gauche dans un accident sur un chantier. Épisode qui lui vaut la Légion d'honneur. Il commente sobrement : « J’ai été exproprié de mon bras ».
Le métropolitain
En 1884, il est muté à Paris. Il prend en charge les chemins de fer de l’Est, puis intègre le service municipal dans les très populaires 18e et 19e arrondissements. Il améliore les égouts, travaille sur l’aménagement des Buttes-Chaumont et conçoit le tramway-funiculaire de Belleville, inauguré en 1890. En 1895, avec Edmond HUET, il rédige un avant-projet de réseau de chemins de fer métropolitain pour la ville de Paris. Les trains doivent être propulsés à l’énergie électrique.
Depuis les années 1860, Londres et New York se sont lancés dans la construction de réseaux de « métros », mais en France, l’opposition des grandes compagnies de chemins de Fer reste forte. Les premiers projets parisiens remontent à 1851. Finalement, le projet de BIENVENÜE est retenu en 1897 et les travaux sont lancés en octobre 1898. Tout doit être prêt pour l’exposition universelle de 1900. La Ligne 1, entre la porte de Vincennes et la porte Maillot, est inaugurée dans les temps, le 19 juillet 1900. Pour l’anecdote, elle était en état une semaine plus tôt, mais une grève des omnibus avait fait craindre aux autorités une trop forte affluence. Le Figaro salue l’exploit de manière ironique, estimant que BIENVENÜE est « l’auteur d’une des plus jolies opérations… césariennes que Paris ait subies. Ce qui ne l’empêche pas d’être un fervent républicain. »
Le développement du métro
Le succès du métro est immédiat et les chantiers pour la deuxième et troisième ligne sont lancés dans la foulée. Ils sont bouclés en cinq ans. La Ligne 4 qui passe sous la Seine, impose des techniques innovantes. Elle est mise en service en 1910. Fulgence BIENVENÜE doit également gérer les premiers drames du métro, comme l’incendie de la station Couronnes, en 1903, qui fait 84 victimes.
En 1914, à 62 ans, Fulgence BIENVENÜE obtient d’être mobilisé comme colonel du Génie, afin de contribuer aux défenses de Paris, alors menacé par l’avance des troupes allemandes. Quelques mois plus tard, le front s’étant stabilisé au nord-est, les autorités le chargent de superviser les chantiers des nouvelles lignes du métro. Il demeure ingénieur conseiller de la ville de Paris jusqu’à sa retraite, à 80 ans, en 1932 ! Et c’est de son vivant que le conseil de Paris décide de lui attribuer le nom d’une station, près de Montparnasse. Il décède quelques années plus tard, le 3 août 1936.
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/histoire/fulgence-bienvenue-pere-du-metro-parisien-23-06-2017-11569722.php#PrxY3EuD74MFTCoW.99image:
Collection RATP
------ ¤¤¤¤¤¤ ------


Publié le 8 juillet 2017
Anne de Bretagne, fille de François II et de Marguerite de Foix, est née le 25 janvier 1477 au château ducal de Nantes.
François II (fils de Richard de Bretagne d'Etampes et de Marguerite) n'a de sa première épouse, Marguerite de Bretagne (décédée en 1469), fille de François Ier (décédé en 1450), qu'un garçon mort en bas âge, et se remarie en 1471, après le décès de Marguerite en 1469, avec une autre Marguerite (fille de Gaston IV, comte de Foix, et d'Eléonore d'Aragon, héritière de Navarre), originaire du comté de Foix. Eléonore d'Aragon est la fille de Jean II roi d'Aragon et de Blanche, reine de Navarre.
Note : Ferdinand V, roi d'Aragon (époux d'Isabelle de Castille) est né d'une première union de Jean II, roi d'Aragon, alors qu'Eléonore d'Aragon est née d'une seconde union de Jean II, roi d'Aragon, avec Blanche, reine de Navarre.
La petite Anne, née en 1477, est sevrée dès son jeune âge par une dame de Rennes, Mme Eon. Anne a une sœur Isabelle (ou Isabeau), née en 1478 et décédée en 1490. François II confie la tutelle de ses filles au maréchal de Rieux et à Lescun. A partir de 1480, Anne et sa sœur ont comme gouvernante Françoise de Dinan, choisie par le trésorier Landais, véritable chef de la maison ducale à l'époque. A noter que Françoise de Dinan, dame de Laval appartenait à la famille des Dinan Montafilan, et était apparentée par sa mère Catherine de Rohan, à la puissante famille des Rohan.
En 1486, Anne, alors âgée de 9 ans, assiste au décès de sa mère Marguerite de Foix. Anne est promise, dès 1486, au titre de duchesse de Bretagne. Dès son jeune âge, Anne devient un jeu dans l'échiquier politique franco breton. De nombreux prétendants se font connaître. En avril-mai 1481, un premier prétendant est présenté par le duc lui-même, qui cherche en Angleterre un appui contre le royaume de France, mais ce projet entre François II et Edouard IV tombe vite à l'eau. Le prince de Galles, fils aîné du roi d'Angleterre, devait épouser la fille aînée du duc lorsque celle-ci aurait eu douze ans, et le duché devait être dévolu au deuxième fils, qui l'habiterait et en porterait les armoiries (« In eventu quo dictus princeps Gallie ex filia predicta herede Britannie plures masculos suscitaverit, ille dux erit Britannie, arma ipsius patrie portabit, & in ea moram faciet, qui in ondine nascendi proximus post heredem Anglie filius aut frater extiterif », Morice, 395). Un autre prétendant est Louis d'Orléans (situé en seconde position après Charles VIII pour le titre de roi de France). Sur les rangs, il y avait aussi François de Rohan, fils de Jean de Rohan, Maximilien d'Autriche (alors âgé de 28 ans) et le sire d'Albrecht (âgé de 47 ans), neveu du vicomte Jean II de Rohan.
François II meurt à Couëron, le 9 septembre 1488 et son corps est d'abord inhumé au Couvent des Carmes, près de sa première épouse, avant de recevoir sa sépulture définitive dans la cathédrale Saint-Pierre (à Nantes), où Anne lui fera construire un magnifique tombeau réalisé par Michel Colombe et achevé vers 1507.
Anne est couronnée duchesse de Bretagne, le 10 février 1489 dans la cathédrale de Rennes par l'évêque du diocèse, Michel Guibé. Pour rétablir son autorité, Anne de Bretagne fait appel à des troupes étrangères : anglaises, espagnoles et allemandes. Le roi d'Angleterre Henri VII lui envoie 6 000 hommes qui débarquent à Morlaix. Le roi d'Espagne, Ferdinand lui envoie 2 000 hommes qui débarquent dans le Sud de la Bretagne, sous la direction du comte de Salinas. Maximilien Ier de Habsbourg (archiduc d'Autriche, roi des Romains de 1486 à 1519, et Empereur germanique de 1493 à 1519) débarque avec 1 500 hommes à Roscoff et contribue sans doute à la reprise de Tréguier, Lannion et Morlaix. Un traité est signé le 22 juillet 1489 à Francfort entre Maximilien et Charles VIII, que la duchesse Anne ratifie le 3 décembre 1489.
Le 16 décembre 1490, Anne de Bretagne (âgée de 13 ans) épouse Maximilien Ier de Habsbourg (âgé de 31 ans et veuf de sa première épouse Marie de Bourgogne). Maximilien, fils de l'empereur Frédéric III, est élu roi de Germanie en 1486 à l'unanimité par les princes allemands et succède à son père en 1493. Il épouse en août 1477 Marie de Bourgogne, fille et unique héritière de Charles le Téméraire (décédée accidentellement en 1482), faisant ainsi entrer les Pays-Bas dans les possessions des Habsbourg. Cette union entre Maximilien et Anne devait permettre à la Bretagne de garder une indépendance totale vis à vis de la France et de l'Angleterre. Mais ce mariage était une violation du traité du Verger puisque Anne n ‘avait pas demandé le consentement du roi de France. Jaloux, le vieux Alain Albrecht, capitaine de Nantes, livre le château aux Français dans la nuit du 19 au 20 mars 1491.
Nota : Battu par les troupes françaises commandées par La Trémoille, à Saint-Aubin-du-Cormier, le 28 juillet 1488, le duc de Bretagne doit signer le traité du Verger, le 19 août 1488. Il promet par ce traité que sa fille et héritière Anne ne se marierait pas sans le consentement du roi de France.
Une ambassade allemande dirigée par Wolgang de Polham arrive en Bretagne, porteuse d'une lettre demandant la main de la duchesse Anne de Bretagne. La mariage est avalisé le 16 décembre 1490 par les Etats de Bretagne réunis à Vannes. Mais Maximilien, retenu en Allemagne, ne peut être présent pour le mariage. Une coutume allemande est alors proposée. Après une messe solennelle, célébrée par l'évêque Guibé, dans la cathédrale de Rennes, le 19 décembre 1490, une cérémonie particulière est organisée le soir même en présence des conseillers d'Anne et de Maximilien : « Anne couchée sur un lit de parade avait sorti sa jambe gauche dénudée, et Wolgang debout à côté du lit, aurait mis sa jambe gauche à côté de celle d'Anne pour signer l’union de son maître avec la duchesse ».
Nota : à signaler qu'à cette époque, Charles VIII (fils et successeur de Louis XI à l'âge de 13 ans), roi de France, était fiancé avec Marguerite de Bourgogne (Marguerite d'Autriche), la propre fille de Maximilien. Anne de Bretagne devenait ainsi sa belle-mère.
Cette union mécontente Charles VIII déjà lié par un mariage blanc avec Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien. Délaissée par Maximilien et le mariage d'Anne avec Maximilien n'ayant pas été consommé, Charles VIII rompt avec Marguerite d'Autriche le 25 novembre 1491 et demande alors à la duchesse de Bretagne de l'épouser. Devant le refus de cette dernière, Charles VIII lui propose alors une dot de 100 000 écus et le choix entre trois époux : Louis de Luxembourg, le duc de Nemours et le comte d'Angoulême. Anne refuse en stipulant qu'elle ne pouvait épouser qu'un « roy ou fils de roy ». Finalement, après mure réflexion et devant l'insistance de nombreux seigneurs bretons qui supplient la duchesse Anne de rompre avec Maximilien, Anne accepte la proposition de mariage avec Charles VIII, roi de France. A noter que Charles et Anne sont cousins à un degré prohibé et doivent donc obtenir une validation du mariage par le Pape. Le 12 novembre 1491, Anne accepte de se montrer nue devant les ducs d'Orléans, le duc de Bourbon, madame de Bourbon, et monseigneur d'Aurigny et on lui demande aussi de marcher pour vérifier sa légère boiterie (le roi voulait en effet savoir si elle n'avait pas de malformations majeures). Les fiançailles entre Anne de Bretagne et Charles VIII ont lieu à Rennes le 15 novembre 1491. Le mariage a lieu à la chapelle du château royal de Langeais, le 6 décembre 1491, avec la bénédiction de Jean de Rely, confesseur du roi. La messe est dite par Georges d'Amboise. Plusieurs témoins sont présents : le duc Louis d'Orléans, le duc de Bourbon, les comtes d'Angoulême, de Foix et de Vendôme, le prince d'Orange, le chancelier Philippe de Montauban, le sire de Coëtquen. Le soir même six bourgeois de Rennes assistent à la consommation du mariage.
Nota : les deux époux se font donation mutuelle de leurs droits sur le duché. Le contrat de mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII stipule que si Anne meure la première, le roi de France devient automatiquement duc de Bretagne et la Bretagne est alors unie à la France. Si le roi, meurt le premier, Anne reste duchesse de Bretagne, mais son fils aîné hérite du duché de Bretagne. Et s'il n'a pas de fils, au moment du décès de Charles VIII, la reine ne peut se remarier qu'avec le roi suivant . Voici quelques passages du texte : « Pour obvier aux guerres (…) qui ont eu cours & acquérir (…) & maintenir paix (…) perpétuelle « Anne », fille & héritière seule& unique « du duc » donne (…) perpetuellement à héritaige audit seigneur, ses successeurs roys de France, par titre de donnaison faite pour cause (…) dudit mariage, au cas qu’elle ira de vie à trespas paravant ledit seigneur sans qu’aucuns hoirs nés & procréés d’eux, les droits, propriétés (…) compétans à ladite dame es duché & principauté de Bretaigne. Et pareillement ledit seigneur (…) donne (…) perpétuellement& à héritage, au cas que ledit seigneur décède (…) avant ladite dame sans aucuns hoirs nés (…) légitimement de leur chair (que Dieu ne veuille) tout tel droit (…) propriété (…) competans audit seigneur, à condition toutefois & pour éviter les (…) guerres (…) que ladite dame ne convolera à autres nopces fors avec le roi futur, s’il lui plaist et faire se peut, ou autre plus prochain présumptif futur successeur de la Couronne (…). En présence & du consentement (…) dudit seigneur prince d’Orenge, prouchain parent ou affin de ladite dame, lequel (…) ratiffie (…) ce que dessus ».
Anne est couronnée reine de France le 8 février 1492 dans la basilique de Saint-Denis. L’office est célébré par André d'Espinay, archevêque de Bordeaux. Le lendemain, Anne fait son entrée solennelle dans Paris, et la cérémonie se termine à Notre-Dame de Paris par une grande messe.
Couronnement d'Anne de Bretagne (XVème siècle)
Charles VIII prend en main le duché de Bretagne dès avril 1491 en convoquant les Etats de Bretagne. Il place, dans le même temps, ses hommes à la tête de l'administration financière. Ainsi, Jean François de Cardonne est nommé général des finances et Thomas Bohier remplace Jean de Lespinay, à la trésorerie générale. Après le mariage, la prise de contrôle est renforcée par l'alignement des institutions bretonnes sur les institutions françaises. Après avoir interdit à Anne de Bretagne de porter le titre de duchesse, Charles VII, par deux ordonnances, l'une du 9 décembre 1493 et l'autre du 16 juin 1494, supprime la chancellerie et la remplace par une cour de justice. Par les ordonnances datées du 7 juillet 1492 et du mois d'octobre 1493, il reconnaît pourtant les privilèges de la Bretagne : privilèges fiscaux avec le droit pour les Etats de consentir à l'impôt et privilèges judiciaires avec la garantie pour les Bretons d'être jugés par les instances de la province.
Maximilien d'Autriche, renonce alors à son titre de duc de Bretagne, et se marie à Bianco Maria (Blanche Srorza), nièce de Ludovic le More. Il réussit à unir les maisons d'Autriche et d'Espagne, en mariant son fils Philippe le Beau avec Jeanne la Folle (héritière des Rois Catholiques et fille de Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille), en 1496. Maximilien négocie aussi le mariage de ses petits-enfants avec les héritiers de Ladislas II Jagellon, qui devait faire passer aux Habsbourg les couronnes de Hongrie et de Bohême en 1526.
Marié, Anne était en charge de faire des enfants du sexe mâle au roi de France. Anne va donner naissance à cinq enfants. Elle accouche le 10 octobre 1492 d'un garçon du nom de Charles-Orland. Elle perd un enfant mâle à deux mois de son terme en août 1493. Elle accouche au printemps 1495, d'une fille mort née. Un garçon, prénommé Charles, naît le 8 septembre 1496 et décède le 20 octobre 1496. Anne accouche à nouveau d'une fille le 20 mars 1498 qui meurt quelques heures après. De ces cinq enfants, seul le premier était né viable. Or ce garçon, le dauphin, meurt à trois ans le 16 décembre 1495, victime d’une épidémie de petite vérole ou de rougeole. A 21 ans, Anne était arrivée à son cinquième échec de ses maternités.
Charles VIII décède le 7 avril 1498, suite à un accident stupide (il se heurte la tête contre le linteau d'une porte dans un couloir du château d'Amboise). La mort soudaine de Charles VIII sans descendance, fait d'Anne une reine douairière de France et la seule propriétaire du duché. Dès le 9 août 1498, Anne redevient duchesse de Bretagne puis rétablit la chancellerie de Bretagne et le conseil de Bretagne « pour ce que entre autres choses y a de tout temps acoustumé avoir chancelerie et conseil serviz et exercez par chancelier et vice-chancelier » avec à sa tête Philippe de Montauban, comme chancelier, et Guillaume Guéguen (abbé de Redon et évêque élu de Nantes), comme vice-chancelier. Jean de Lespinay, pour sa part, retrouve la trésorerie générale, dont il avait été écarté par le roi Charles VIII.
Anne de Bretagne a alors 21 ans et Louis XII (Louis, duc d'Orléans, fils de Charles d'Orléans et de Marie de Clèves), son cousin et successeur de Charles VIII, a 36 ans. Louis XII est marié à Jeanne de France, fille disgracieuse de Louis XI, depuis 1476. Anne s'engage à épouser Louis XII dès que l'union avec Jeanne de France est annulée. La répudiation de Jeanne est officielle le 17 décembre 1498 après l'accord du Pape Alexandre VI, dit Borgia (d'origine espagnole). Le texte du contrat de mariage entre Louis XII et Anne de Bretagne est signé le 7 janvier 1499. Le contrat de mariage est accompagné d’un traité par lequel Louis XII s'engage à respecter les privilèges de la Bretagne et les institutions bretonnes (Parlement, Chancellerie, Chambre des Comptes et Trésorerie générale) sont confirmés. Le mariage a lieu à Nantes dans la chapelle ducale, le 8 janvier 1499.
Nota : une clause nouvelle régente les conditions de succession : en effet, si Anne décède la première, le duché de Bretagne revient au deuxième fils ou au deuxième petit-fils s'il n'y a qu'un seul fil au cours du nouveau mariage. Voici le texte : « Si icelle dame alloit de vie à trespas avant le roy Très Chrestien sans enfans d’eux ou que la lignée d’eux procréée … défaudroit, en ce cas ledit roy Très Chrestien jouira desdits duché de Bretaigne & autres pays & seigneuries que ladite dame tient à présen. ;& apprès le déceds du roy Très Chrestien, les prochains vrais héritiers de ladite dame succéderont auxdits duché & seigneuries, sans que les autres roys et successeurs en puissent quereller ». Une autre clause prévoit : « A ce que le nom de la principauté de Bretaigne ne soit & demeure aboli pour le temps avenir … & que le peuple d’icelui pays soit secouru & soulagé de leurs nécessitez & affaires, a esté accordé que le second enfant masle, ou fille au déffaut de masle, venant de leurdit mariage … seront & demeurreront princes dudit pays … &s’il advenoit que deux … n’yssit … qu’un seul enfant masle, et que dicelui masle cy après yssissent … deux ou plusieurs enfansts masles, ou filles ils succéderont pareillement audit duché, comme dit est ».
Une fille, prénommée Claude, naît le 15 octobre 1499. Un garçon naît le 21 janvier 1503 mais meurt aussitôt. Onze ans, plus tard, après plusieurs maternités difficiles, Anne a une autre fille, prénommée Renée, qui naît le 20 octobre 1510. En 1512, le 21 janvier, elle accouche d'un garçon mort-né. Anne n'arrive pas à avoir des garçons viables pour la succession royale.
Anne de Bretagne envisage de marier sa fille Claude à Charles de Luxembourg (le futur Charles-Quint), petit fils de Maximilien Ier de Habsbourg (Maximilien d'Autriche), âgé d’un an. Tout commence par l'arrivée à Lyon au début de 1501 de Philippe le Beau, époux de Jeanne la Folle (fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille), père de Charles, qui vient discuter du mariage de son fils (âgé de deux ans) avec Claude de France (âgée de trois ans). Un traité (le traité de Blois) conclu le 22 septembre 1504 et où Louis XII promet de marier sa fille avec Charles, futur souverain des Pays-Bas, et de lui accorder, outre son héritage de Bretagne, une dot comprenant les duchés de Bourgogne et de Milan, est ratifié par Anne de Bretagne à Orléans douze jours plus tard. Mais, le 10 mai 1505 , le roi de France, Louis XII, prend la décision définitive de marier sa fille Claude à François d'Angoulême (futur François Ier). Il rédige pour cela un testament où il rompt les fiançailles de Claude et Charles et ordonne un mariage rapide avec François d'Angoulême. De juin à fin septembre 1505, Anne de Bretagne part effectuer un pèlerinage dans le duché de Bretagne, le Tro-Breiz (tour de Bretagne). Les fiançailles de Claude et de François, célébrées par le cardinal Georges d'Amboise, ont lieu le 21 mai 1506. Le mariage a lieu le 18 mai 1514 à Saint-Germain-en-Laye. Dès le 25 octobre 1514, François Ier reçoit de Louis XII le pouvoir d'administrer la Bretagne.
Anne de Bretagne décède à Blois le 9 janvier 1514 après être tombée malade le 2 janvier 1514 et sans avoir sacrifié l'indépendance de sa chère Bretagne. Elle est ensevelie dans la basilique Saint-Denis. Son cœur arrive à Nantes le 13 mars 1514 et il est déposé provisoirement dans l'église des Chartreux. Ce n'est que le 19 mars 1514 que le cœur arrive au Couvent des Carmes de Nantes et qu'il est déposé dans la tombe de François II, son père.
Louis XII épouse Marte d'Angleterre en octobre 1514, avant de décéder dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1515. François d'Angoulême, fils de Louise de Savoie et époux de Claude (fille d'Anne de Bretagne) accède alors au trône de France sous le nom de François Ier. Claude devient reine de France à l'âge de 14 ans. Dès le 22 avril 1515, François d'Angoulême obtient le duché de Bretagne si Claude décède la première. Le 28 juin 1515, Claude lui en fait une donation définitive. François Ier décide ensuite que le duché revient au dauphin et non au deuxième fils de Claude. Ce dauphin, prénommé également François, devient plus tard le duc François II en 1524. Le dauphin garde le titre de duc qui disparaît en 1547.
Fiançailles de François d'Angoulême et de Claude de France (XVIème siècle).
Claude décède à Blois le 20 ou 30 juillet 1524 à l'âge de 25 ans. En 1524, à la veille de son décès, la reine Claude accepte d'instituer par testament son fils aîné héritier universel. Eléonore d'Autriche (sœur de
Charles-Quint) devient la seconde épouse de François Ier après la mort de Claude de France. En 1528, Renée, sœur de Claude de France, est mariée à Hercule d'Este, duc de Ferrare, et reçoit le duché de Chartres contre la renonciation aux droits qu'elle peut prétendre sur la succession d'Anne de Bretagne. Pour obtenir le consentement de la population bretonne, François Ier va s'appuyer sur la riche noblesse du duché : en 1525, Jean de Laval, baron de Châteaubriant, entre au conseil du roi, et en août 1526, Guy (XVI), comte de Laval, est promu gouverneur. C'est le 6 août 1532, que les Etats généraux de Vannes approuvent le rattachement du duché de Bretagne au royaume de France. Le 13 août 1532, François Ier publie à Nantes l'édit d'union du duché de Bretagne au royaume qui précise que les « droits et privilèges » du pays seraient respectés. Le 21 septembre 1532, le roi de France publie au château de Plessis-Macé un Edit qui unit irrévocablement la Bretagne à la couronne royale de France.
Nota : le blason des ducs de Bretagne était d'hermines plein, et portait la devise "Potius mori quam foedari" (plutôt mourir qu'être souillé).
Nota : UNE LETTRE DE LA DUCHESSE ANNE AUX HABITANTS DE RENNES. — La pièce dont nous donnons ici le texte inédit est, extraite des archives municipales de Rennes, qui nous fourniront encore plus d'une fois de curieux documents. Le duc François II venait de mourir le 9 septembre 1488, à Coiron (aujourd'hui Couëron), près de Nantes, laissant à sa fille Anne une couronne mal affermie et un pays divisé, envahi, en proie aux intrigues du dedans et aux convoitises d'un ennemi puissant et redoutable, déjà maître d'une bonne partie des places fortes du duché. Le Roi de France, dont les troupes venaient de disperser, à Saint-Aubin-du-Cormier, la dernière armée bretonne, avait pourtant accordé la paix au vieux duc mourant, d'après l'avis de son chancelier, Guy de Rochefort. La mort n'avait pas laissé à François II le temps d'exécuter les conditions du traité, dictées au Verger, par le roi, dans le mois d'août, et ratifiées à Couëron par le duc de Bretagne. Pendant que les intrigues, pour marier la jeune duchesse, héritière de la Bretagne, s'agitaient autour d'elle et divisaient les seigneurs de sa cour en factions plus acharnées entre-elles que contre l'ennemi extérieur, Anne, retirée à Guérande, avec son tuteur Jean de Rieux, maréchal de Bretagne, échangeait des ambassades avec le Roi de France, et adressait en même temps à ses fidèles bourgeois de Rennes la lettre suivante, signée de sa main : « De par la Duchesse. Nos bien amez et feaulx, vous scavez le deceix avenu du Duc nostre très redoubté seigneur et père que Dieu absolle, qui nous est et à tout le pais dure chose à porter, fors le reconfort de sa très-belle fin ; en son vivant peu de temps avant son deceix eut troicté de paix avec le Roy, lequel par avant son deceix me commanda tenir, que suys delibérée de faire. Mais pour ce que en celui troicté y a aucuns pouaints et promesses qui restent estre acomplies tant de la part du Roy que de nous, en actandant les Estatz de nostre dit pais lesquelz avons mandez, vous prions et neantmoins mandons que promptement et en toute diligence vous chouaissisez tant de gens d'église, gens de conseil que bourgeois jucques au nombre de seix bons personnaiges des plus notables et scavans de nostre ville de Rennes, pour venir devers nous ; car en déliberacion de ce que sommes tenuz faire touchant ledit troicté et autres noz affaires, desirons avoir voz conseilz et avis comme de ceulx en qui avons seurté et qui tousiourz ont esté à noz predecesseurs et au bien de leurs pais bons et loyaulx subgectz et que esperons que soyez envers nous. Et à tant soyez Dieu qui, noz bien amez et feaulx, vous veille preserver et tenir en sa garde. Escript à Guerrande le XVIe jour de septembre. Signé : Anne, et plus bas : DEFORESTZ ». [Note : La suscription de ladite lettre est ainsi conçue : « A noz bien amez et feaulx les gens d'eglise, gens de justice, bourgeoys et habitans de nostre ville de Rennes »].
CHRONOLOGIE :
-
26 juin 1471 : Mariage de François II, duc de Bretagne, et de Marguerite de Foix, fille de Gaston IV, comte de Foix, et d'Eléonore d'Aragon, héritière de Navarre.
-
25 janvier 1477 : Naissance d'Anne de Bretagne à Nantes.
-
16 avril 1481 : François II et Maximilien d'Autriche signent un traité d'alliance contre Louis XI.
-
10 mai 1481 : François II et Edouard IV d'Angleterre signent un traité d'alliance contre Louis XI. Anne de Bretagne est promise en mariage au prince de Galles, ou à défaut à son frère cadet, le duc d'York.
-
Début 1484 : Assassinat des enfants d'Edouard IV (le prince de Galles et le duc d'York) par leur oncle Richard III.
-
Janvier 1487 : Louis d'Orléans s'échappe de la cour de France et se réfugie en Bretagne.
-
Fin mai 1487 : Une armée française de 15 000 hommes envahit la Bretagne.
-
28 juillet 1488 : Défaite de l'armée bretonne à Saint-Aubin-du-Cormier. Le duc d'Orléans est fait prisonnier par les Français.
-
10 février 1489 : Anne de Bretagne est couronné duchesse de Bretagne à la cathédrale de Rennes.
-
27 octobre 1490 : La duchesse Anne de Bretagne adhère à la ligue formée contre Charles VIII, roi de France, par Maximilien d'Autriche et Henri VII d'Angleterre.
-
19 décembre 1490 : Mariage par procuration de la duchesse Anne de Bretagne et de Maximilien d'Autriche (Maximilien Ier de Habsbourg).
-
Fin mai à octobre 1491 : Les Français se rendent maîtres de la Bretagne à l'exception de la ville de Rennes.
-
15 novembre 1491 : Signature du traité de Rennes qui conclut la paix entre Anne de Bretagne et Charles VIII.
-
6 décembre 1491 : Mariage d'Anne de Bretagne et de Charles VIII.
-
8 février 1492 : Anne de Bretagne est couronnée reine de France à Saint-Denis.
-
Mars à juin 1492 : Complot breton ayant pour but de livrer la Bretagne aux Anglais.
-
9 décembre 1493 : Charles VIII supprime la Chancellerie de Bretagne.
-
7 avril 1498 : Décès du roi de France Charles VIII.
-
9 avril 1498 : Anne de Bretagne rétablit la Chancellerie.
-
27 mai 1498 : Louis d'Orléans est sacré roi de France et devient Louis XII.
-
28 septembre 1498 : Anne de Bretagne préside les États de Bretagne à Rennes.
-
8 janvier 1499 : Mariage d'Anne de Bretagne et de Louis XII.
-
Août 1501 : Premières négociations en vue de marier Claude, fille d'Anne de Bretagne, et de Louis XII, à Charles de Luxembourg (futur Charles-Quint).
-
18 novembre 1504 : Anne de Bretagne est reine de France pour la deuxième fois.
-
10-31 mai 1505 : Testament du roi ordonnant le mariage de Claude, fille d'Anne de Bretagne, avec François de Valois-Angoulême.
-
Juin à fin septembre 1505 : Tro Breiz d'Anne de Bretagne en Bretagne.
-
21 mai 1506 : Fiançailles de Claude, fille d'Anne de Bretagne, avec François d'Angoulême.
-
9 janvier 1514 : Décès d'Anne de Bretagne.
-
16 février 1514 : Inhumation d'Anne de Bretagne à Saint-Denis. Les cérémonies funèbres durent cinq semaines.
-
19 mars 1514 : Le cœur d'Anne de Bretagne est déposé au Couvent des Carmes à Nantes.
------ ¤¤¤¤¤¤ -----

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
Publié le 08 juillet 2017
Un Hercule breton, le philosophe Charles-Hercule de Kéranflec’h,
par François Labbé
Maupertuis que nous venons d’évoquer est une personnalité dont le rayonnement est mondial, incontestablement un des phares des Lumières. À côté de lui, d’autres savants bretons, d’autres philosophes auront, en dépit de la force de leurs idées une renommée bien moindre. Ainsi va le monde…
C’est en particulier le cas de Charles-Hercule de Kéranflec’h ou Keranflech dont l’œuvre attend toujours l’étude sérieuse qu’elle mérite [1].
Sa vie se résume en quelques dates. Il voit le jour au manoir de Launay et est baptisé le 4 février 1711 à Botmel avec pour parrain le comte de Boiséon, lié aux meilleures familles de l’aristocratie bretonne.
Manoir du Launay, Pluquellec (22)
Sieur de (ou du) Launay (en Callac), Trensvern et Rosquelfen, il se marie le 15 juillet 1745 à Duault avec Perrine Marguerite du Leslay, dame de Chefbocage. Il mène une vie de gentleman-farmer accordant tous ses loisirs à l’étude et l’écriture. Il aura une fille et un fils qui rejoindra la chouannerie sous le nom de La Douceur. Il décède au château de Rosneven le 28 février 1787. Le lendemain, on l’inhume dans l’enfeu de Bodillio en l’église paroissiale de Pestivien [2].
Ce gentilhomme breton, retiré dans ses terres, publie tardivement beaucoup d’ouvrages.
À cinquante ans, en 1761, il fait paraître chez l’imprimeur rennais Vatar son grand œuvre, L’hypothèse des petits tourbillons, justifiée par ses usages, où l’on fait voir que la physique, qui doit son commencement aux tourbillons, ne peut être mieux perfectionnée qu’en poussant le principe qui l’a fait naître. Cet ouvrage est à la fois le complément, la défense et l’illustration de la théorie de Descartes revue et amendée par Nicolas Malebranche, son véritable père spirituel. Il veut justifier cette hypothèse (le titre insiste sur le terme) des tourbillons par ses usages (Discours préliminaire).
Trois années après, il récidive avec un Essai sur la raison, ou nouvelle manière de résoudre une des plus difficiles et des plus belles questions de la philosophie moderne (Rennes, Vatar, puis, Paris, 1765), un livre qui aura, comme le premier, un certain impact.
Viendront ensuite, toujours chez Vatar, un Nouvel examen de la question de l’ame des bêtes qui renvoie au livre célèbre de son compatriote Bougeant (auquel il s’oppose : « Il fait agir Dieu comme agirait un imbécile ») et bien entendu aux affirmations de Descartes qu’il prône et développe, puis, une Suite de l’essai sur la raison, avec un nouvel examen de la question de l’âme des bêtes (1768), une Dissertation sur les miracles (1773), des Observations sur le cartésianisme moderne, pour servir d’éclaircissement au livre de l’hypothèse des tourbillons (1774), un Recueil d’opuscules (1778), l’Explication historique du livre de l’Apocalypse (1783, réédité après sa mort), enfin, en 1785, son Idée de l’ordre surnaturel (suite des Opuscules).
Ce ne sont bien entendu là que ses ouvrages imprimés. On peut rêver des manuscrits tapis en son manoir, songé à la bibliothèque qu’il avait dû se constituer…
Kéranflec’h se distingue radicalement par sa pensée du Président de l’Académie de Berlin marqué par le sensualisme, l’empirisme et tenant du newtonisme (son introducteur en France avant Voltaire !), alors que lui se voudra essentiellement cartésien[3]. Disciple de Descartes et surtout de l’Oratorien Malebranche (l’Encyclopédie ne voudra voir que des rêveries sans substance dans l’œuvre de celui-ci !), il prend place dans le « camp » des philosophes sinon opposés aux Lumières au moins méfiants vis-à-vis d’elles, de leur esprit de système et des conséquences matérialistes qu’il prédit.
Dans son Essai sur la raison, il manifeste ainsi cet attachement à Malebranche tout en s’efforçant d’y adjoindre une métaphysique « modernisée ».
En fait, alors que l’étoile de Descartes a décliné (sauf en ce qui concerne sa « méthode », son « mécanisme » et sa géométrie bien entendu) et que, pour un temps au moins, la philosophie qui tient le haut du pavé s’en détourne pour prôner l’héritage de Locke et de Bacon, quand en France, la prévalence des préoccupations pratiques et politiques rejette dans l’ombre l’apolitisme et le solipsisme du cogito cartésien, en bref quand l’empirisme prend le pas sur l’idéalisme, on ne doit pas s’étonner de voir ce Breton assez isolé en son manoir, éloigné des grandes villes rejoindre par la pensée le philosophe dans son poêle : deux solitaires qui refont le monde dans l’abstraction et le retrait, mais à l’unisson quasiment à un siècle de distance, alors que ce monde a bien changé et que ce changement va encore s’accélérer !
À cette parenté de situation s’ajoute aussi le patriotisme breton : L. Robert le faisait remarquer d’emblée dans son article sur Kéranflec’h : défendre la philosophie de Descartes, la reformuler, c’est certes un devoir d’honnêteté philosophique pour rappeler au moins qui est le père de la « philosophie naturelle », mais c’est aussi un devoir patriotique car, pour lui, nul doute, Descartes était breton [4] :
« Toute la France doit s’intéresser à soutenir l’honneur de Descartes […], mais de toutes les parties du royaume, nulle ne doit montrer plus de sensibilité que cette province. (L’hypothèse des petits tourbillons, justifiée par ses usages, Discours préliminaire. P. 31-32).
« Cette province », c’est bien sûr la Bretagne et, se faire le défenseur de Descartes, c’est donc bien un acte patriotique [5] !
Quelques années plus tard, Marie Auguste Mareschal, dans l’article qu’il lui consacrera dans son Armorique littéraire, indiquera de même : « Quoique ce grand homme soit né sur une terre étrangère, il n’en est pas moins essentiellement Breton ». Il n’est pas non plus étonnant de découvrir chez lui une parenté avec un autre auteur breton qu’il n’a pu manquer de connaître, fidèle à Descartes et ami de Malebranche : le père Yves-Marie André dont nous avons évoqué la figure dans une précédente chronique.
Ainsi, dans son premier ouvrage sur les petits tourbillons, il reprend en fait l’idée de Malebranche, qui complète la pensée de Descartes comme une démonstration appliquée à l’infiniment petit qui viendrait compléter l’infiniment grand imaginé par le maître. Il s’efforce en outre d’y donner des preuves, d’en montrer l’intérêt pour tous les domaines de la physique, car Kéranflec’h sait mettre son érudition (et ses écrits prouvent qu’elle était immense) au service de ses convictions et de ses démonstrations.
Son but essentiel est d’accorder la foi et la raison, « ce que dit l’Église et ce que dit Monsieur Descartes » (p. 324) ou plutôt de montrer que si on a opposé ces deux domaines essentiels, c’est par manque de savoir, parce que la plupart des penseurs n’ont pas ce recul que permet le savoir philologique et l’examen direct des textes : « […] faute de faire attention au langage de chaque siècle et à la situation des écrits qu’on cite, on jette souvent de l’obscurité sur les Conciles et les Pères » (p. 325).
C’est ainsi qu’il montre une congruence entre la Genèse et la théorie cartésienne des tourbillons[6] puisque ceux-ci, conséquences du « souffle de Dieu » constituent à son avis le premier mouvement qui met en branle la matière d’abord étale et homogène, le « liquide » de Moïse. Ce mouvement lancé se développe en tourbillons infiniment petits et infiniment grands (l’éther universel des Cartésiens) : « Le seul phénomène des tourbillons et des forces centrifuges explique la pesanteur », lance-t-il alors aux newtoniens ! Nous qui discutons parfois à tort et à travers des « Big bang » et « Big crunch », nous ne perdrions pas notre temps à (re)lire Kéranflec’h !
Je n’entrerai pas dans ce débat fort complexe et impossible à résumer dans une notice biographique. Ajoutons seulement que le philosophe développe certes fidèlement les idées de Malebranche mais il les complète, les rend plus accessibles même si sa lecture n’est pas toujours aisée. Francisque Bouillier écrivait que dans l’univers imaginé par l’oratorien, il a ménagé un chemin « tout neuf » !
Ses pensées sur la lumière et les couleurs vont très loin (il se pourrait que Goethe en ait eu connaissance) et annoncent des découvertes bien plus tardives : « La lumière tire son origine du mouvement de vibration que les parties subtiles et insensibles des corps lumineux donnent au milieu environnant ».
Il en va de même sur sa théorie de la sympathie ou sur ce qu’il dit de l’infinité de l’étendue intelligible et l’infinité absolue de Dieu (tout en reprochant à Newton et Clarke de confondre immensité divine et immensité spatiale).
Sur le plan de la religion, les débats de son temps l’intéressent peu : il regrette qu’on ne sache plus lire les textes des pères de l’Église et tient en peu d’estime les théologiens de tout acabit : « Quand il s’agit de raisonner sur la conduite de Dieu, les théologiens commencent à se mettre en place », dit-il non sans férocité...
Kéranflec'h, qu’on a tendance à opposer à la science de son temps, ne fait pourtant qu’énoncer les principes de la science moderne :
« Je ne dis pas qu’on a tort de faire des expériences. On n’en saurait trop faire. On ne peut trop s’assurer des faits. Mais je dis qu’on a tort d’en faire dans principes préalables et sans vues, sans un plan qui les lie ensemble, en un mot sans un système clair, fondé sur les notions communes des mécaniques et du bon sens, qui apprenne à bien voir les faits, qui fasse bien discerner ce qu’ils disent, et qui nous garde ainsi nous-mêmes de croire y voir ce qui n’y est pas » (Hypothèse, p. 325).
Le moraliste qu’il est fondamentalement sait faire la part du bon grain et de l’ivraie et il ne condamne que les déviations de l’esprit scientifique en un temps où chacun veut disposer d’un « cabinet d’instruments » : l’absence de projet précis, le rejet pur et simple du passé, le goût de la nouveauté pour la nouveauté, un manque de culture certain chez bien des « savants ». Il ne s’oppose pas vraiment à l’empirisme, à la place de l’expérience, mais considère qu’une collection d’observations ne remplacera jamais la quête d’un système du monde et il raille tous ceux qui « ont beau assembler tous leurs amis et s’électriser tous ensemble avec tous les meubles. […] On ne voit pas que cela les avance vers la cause de l’électricité » (Hypothèse…, P. 326).
Il n’est pas non plus ce personnage un peu rétrograde que les auteurs superficiels « expédient » en quelques phrases, un admirateur aveugle de Descartes. Il écrit ainsi avec des accents dignes des encyclopédistes :
« Je ne dis pas que l’on ait eu tort de renoncer aux explications de M. Descartes : mais je dis qu’on n’aurait jamais dû abandonner sa méthode, qu’on aurait dû s’attacher inviolablement à n’admettre que des idées claires, des causes mécaniques, et des explications uniquement déduites des figures, des configurations, et des mouvements de la matière. En suivant cette méthode, on eût corrigé les défectuosités de Descartes ; on eût rectifié son système ; et plusieurs eussent conduit à sa perfection ce qu’un seul ne put autrefois qu’ébaucher, dans le peu de temps qu’il eut à vivre. » (Observations sur le cartésianisme…, P. 50 et suivante)
Il s’est penché sur quantité d’autres domaines, sur la littérature, sur les livres sacrés…, ses réflexions sur l’idée et sa nature annoncent Kant et toujours il rédige avec ces qualités que lui reconnaissait L. Robert : un « style entraînant et plein de charme […] un grand art de la composition. D’habiles accumulations de textes et de belles pages », auxquelles nous ajouterons une grande clarté et un humour parfois cinglant. Pour le lecteur moderne, s’il y a parfois des difficultés de lecture, elles proviennent moins d’une écriture que certains n’ont pas hésité à qualifier un peu vite de scolastique que d’une pensée qui utilise tous les domaines de l’érudition, domaines qui ne sont hélas ! plus toujours accessibles aisément !
Ses ouvrages sont aussi parcourus de réflexions sur la société, sur l’homme et montrent qu’il est un profond moraliste dans la lignée de La Bruyère, qui, bien que n’ayant pas ou peu quitté son canton, connaît le monde :
Évoquant le rapport des hommes de son temps à Dieu, il note ainsi :
« On le dépouille de ses attributs pour les distribuer aux créatures. Le grand, le riche, le brutal, le superbe s’approprient la force et la puissance. Le savant se donne pour une lumière. Le libertin, le voluptueux croit devoir ses plaisirs aux objets qui les occasionnent. L’honneur et la gloire dus à Dieu seul sont à une espèce de pillage duquel tous les êtres remportent quelque chose, hors celui auquel tout est dû. »
Ailleurs, il supplie ses contemporains de préserver l’héritage cartésien, de le développer, de l’améliorer peut-être et de ne pas sombrer dans la futilité des petits-maîtres :
« […] n’abandonnons jamais des idées nettes, des vérités démontrées, une théorie intelligible, une physique lumineuse, parce qu’elles ont le malheur de n’être pas à la mode […] ».
Devant l’inconstance humaine, il peut donner l’impression de se laisser aller à un certain pessimisme ou fatalisme :
« Tout est fortune en ce bas monde. L’inconstance hymen a droit sur tout, il y a des modes pour les systèmes et pour les opinions comme pour autre chose. »
Mais il sait relativiser cette inconstance, lui le sectateur d’un malebranchisme peu en honneur après 1750[7] :
« Que celui qui est en vogue ne s’en glorifie pas, il n’en retombera que plus vite, et celui qui tombe, qu’il se console, il en sera plus tôt relevé ».
Si on rapproche cet idéaliste du matérialiste La Mettrie, on constate que ce sont deux Bretons qui tiennent les positions extrêmes de la philosophie quant à la nature de l’homme et à la matière, deux Bretons qui exploitent de manière la plus opposée qui soit le fameux dualisme cartésien…
Hélas [8] ! ce philosophe campagnard n’a pas eu la reconnaissance qu’il méritait même si l’abbé Joannet s’appuie explicitement sur sa pensée pour écrire son livre, jadis fort prisé : De la connaissance de l’homme dans son être et dans ses rapports (1775)[9]. Loin de Paris, isolé, sa voix a été peu entendue, même si les journaux ont toujours été attentifs à ce qu’il écrivait et ont toujours manifesté un réel intérêt (Mémoires de Trévoux, Journal des savants (article important de décembre 1774), Gazette littéraire de l’Europe, Correspondance littéraire, philosophique et critique, L’Année littéraire de Fréron). Pour The Monthly Review de 1774, il est « un auteur très savant et très sensible » manifestant « beaucoup d’esprit et de dextérité » qui a su montrer les insuffisances du newtonisme comme l’insuffisance de l’attraction pour expliquer la réfraction de la lumière et la réfrangibilité des couleurs…
Nous dirons encore qu’il est un de ces auteurs que les grands philosophes ont rarement cités mais dont ils n’ont pas hésité à reprendre à leur compte certaines de leurs idées !
En guise de conclusion, impossible de ne pas reprendre cette belle phrase de Geneviève Rodis-Lewis dans son article sur Charles-Hercule de Kéranflech, en faisant toutefois des réserves sur l’ « archaïsme » :
« Cependant, comme l’archaïsme général de la statuaire bretonne relativement à son époque n’amoindrit pas notre admiration, ainsi Kéranflech a-t-il donné à sa reconstruction du malebranchisme la solidité parfois un peu lourde, mais aussi la pureté de forme du granit ».
NB : Une thèse intéressante sur la place de la physique au XVIIIe siècle (accessible sur internet) : Patrick Guyot, La mise en place d’une nouvelle philosophie de la physique au 18e siècle. Université de Bourgogne, 2012.
[1] L. Robert a donné toutefois plusieurs suites intéressantes sur son œuvre dans les Annales de Bretagne (1886 T. 1 p. 96-114 et P. 253-256 ; T.2 146-160 ; 1887, t. 3, P. 431-446 ; 1888, t. 4, P. 520-539 ; 1890, t. 6 p. 79-110 ). Il avait été précédé par quelques remarques de Miotcec de Kerdanet (Notices…), quelques pages que lui avait consacrées Francisque Bouillier dans son histoire de la philosophie cartésienne. Geneviève Rodis-Lewis a aussi rendu hommage à sa sagacité dans un article de la Revue philosophique de Janvier-Mars 1965 : « Un malebranchiste méconnu : Kéranflech ». Tanja Thern dans sa thèse Descartes im Licht der französischen Aufklärung, Heidelberg, 2003, lui consacre quelques bonnes pages.
[2] Voir Jérôme Caouen et son étude généalogique
: http://tyarcaouen.free.fr/publications/De%20Keranflech.pdf
[3] Toutefois, il ne rejette pas les principales découvertes de Newton comme la pesanteur mais s’en prend à la prétention des newtoniens de ne s’appuyer sur des faits observés alors que ce ne sont souvent que des « faits conclus », à leurs démonstrations qui manquent de rigueur et s’amuse à pousser certaines de leurs assertions jusqu’à l’absurde !
[4] S’il voit le jour en Touraine, René Descartes est très lié à la Bretagne : son père conseiller au Parlement à Rennes épousera en seconde noces Jeanne Morin, fille de Jean Morin, seigneur de la Marchandrie, propriétaire du château de Chavagne à Sucé près de Nantes, avocat du roi, président de la Chambre des Comptes et maire de Nantes ; sa nièce (née à rennes), Catherine, se considérera toujours comme bretonne ! Son frère Pierre, conseiller au Parlement de Bretagne, comme leur père, épousera Marguerite Chohan, dame de Kerleau en Elven. Voir Sigismond Ropartz, La Famille Descartes en Bretagne, Rennes, 1877 et Simon Alain, Descartes Breton ? Yoran Embanner, 2013.
[5] La défaite de la Guerre de Sept Ans provoqua aussi chez de nombreux auteurs un tel « réflexe » patriotique contre l’Angleterre et ses prétentions et contre l’anglomanie ambiante, contre la philosophie anglaise…
[6] « […] l’hypothèse complète des tourbillons forme l’explication littérale du 1er chapitre de la Genèse », écrit-il (p. 320).
[7] Cependant, Kéranflec’h n’est pas un isolé : Huygens peu après Descartes et avec une approche scientifique, Dambézieux, Villemot, de Molières, Gamaches, Euler même sont aussi partisans de la théorie des tourbillons et pensent qu’elle peut se développer, s’améliorer, rejetant le gravitationnisme, qui leur paraît aventureux ! Kéranflech écrit ainsi : « Mais les principes Newtoniens ne sont ni évidents, ni naturels. Le principe du vide n’est ni démontré, ni susceptible de démonstration. Le vide n’est ni un être, ni une manière d’être.[…] » =observations…, p. 106)
[8] Mais pourquoi « Hélas! » ? La gloire, la réputation est-elle un critère suffisant ? Kéranflec'h a écrit, ses livres existent, sa pensée traverse les siècles. Tant pis pour ceux qui n’ont pas lu au moins un de ses ouvrages (pour la plupart accessibles sur internet) !
[9] Notons tout de même qu’on le lit aussi avec intérêt en Bretagne. En mai 1762,Vincent Pocard du Cosquer de Kerviler note dans son journal : « Exercice de philosophie à l’occasion d’un ouvrage sur l’hypothèse des petits tourbillons, publié récemment à Rennes par M. de Kéranflec'h qui veut perfectionner les idées de Descartes et qui n’ admet pas la nouvelle théorie newtonienne sur la physique, attendu qu’elle comporte que toute matière gravite, ce qu’on ne peut prouver, et qu’une gravitation non universelle cadre mieux avec les mouvements célestes. A la place, M. de Kéranflec'h met le [pl ?,] et à l’attraction il substitue l’impulsion. La lumière n’est plus une émanation des parties propres du soleil, mais le mouvement des globules élastiques de l’éther, mis en action par les vibrations sans déplacement des corps lumineux. Sur tout cela, on disputa beaucoup, mais en somme on ne sait pas grand-chose. Mundum tradidit disputationibus forum. » (pdbzro.com/pdf/vincentpocard.pdf)
------ ¤¤¤¤¤¤ ------

Publié le 19 février 2017: Arthur de La Borderie, par François Labbé - 7seizh.info
La Bretagne très tôt a eu ses historiens. Pierre Le Baud, Bernard d’Argentré, Pierre Landais, Dom Lobineau ou Dom Morice, pour ne citer que quelques noms, ont produit des sommes considérables qui ont permis de préserver la mémoire de la province et conservent un grand intérêt même si de tels écrits sont marqués par les habitudes des temps où elles ont vu le jour.
Il faut attendre le milieu du XIXe siècle avec Arthur Le Moyne de La Borderie pour que la méthode érudite s’impose dans les études sur l’histoire de la Bretagne alors que les historiens celtomanes font de l’histoire davantage l’objet d’un récit, souvent sans grandes bases documentaires, que d’une recherche méthodique. L’Histoire étant d’abord histoires.
Arthur de La Borderie appartient à l’une des plus anciennes familles de Vitré, celle des Lemoyne ou Le Moyne, qui, durant quatre siècles, s’est distinguée au service du Parlement de Bretagne, de la Cour des Comptes et de l’Église et dont une branche acquit en 1510 la terre de la Borderie.
Élève du collège royal de Rennes, Arthur – qui voit le jour en 1827 à Vitré dans le vieil hôtel familial de la place du Marchix – est marqué par un de ses professeurs historien, un oncle de François-Marie Luzel, Julien-Marie Le Huërou (1807-1843) que Michelet appréciait pour sa rigueur et avec lequel il correspondait. Notons que ce professeur, sur la lancée des précurseurs de l’Académie Celtique (créée en 1805), est un des premiers à collecter contes, chants et légendes en Bretagne à la suite d’Aymar de Blois (1760-1852), du comte Jean-François de Kergariou, de Madame de Saint-Prix ou du Chanoine Mahé. En effet dès les années 1825 avec Jean-Marie Penguern et Jean-René Kerambrun (1813-1852), il se lance dans la collecte en Trégor. C’est aussi l’époque où des érudits comme le chevalier de Fréminville, Émile Souvestre ou Louis Dufilhol (1791-1864) font connaître ces collectes au grand public. La parution en 1839 du Barzaz Breiz, d’Hersart de La Villemarqué, est l’événement qui illustre alors l’originalité de la tradition poétique de langue bretonne tandis que les chants de Haute Bretagne seront collectés un peu plus tard. Les collecteurs de l’époque ont au moins trois buts :
-
prouver que cette poésie populaire constituée en majorité de chants appartient de plein droit à la littérature,
-
rechercher tout ce qui concerne l’histoire de la Bretagne.
-
montrer la richesse du patrimoine populaire, son ancienneté et son originalité,sauvegarder tout ce qui risque de disparaître.
On le voit, l’ambiance du temps, les relations du jeune Arthur, ses professeurs, cette vieille ville de Vitré, tout est en place pour que l’amour de l’histoire de la Bretagne s’empare de lui[1].Pourtant, ce penchant qui se manifeste tôt n’est pas du goût de son père qui veut faire de lui un avocat. En fils obéissant, il accepte donc d’étudier le droit, à Rennes puis à Paris. Il obtiendra ce titre de juriste désiré par les ambitions paternelles, mais ce sera tout ce qu’il concédera : il n’exercera jamais. C’est sa façon de faire cohabiter deux exigences opposées, une attitude qui marquera toujours sa personnalité.
Il commence par jeter un regard critique sur le mélange d’histoire et de légendes qui fait encore alors trop le tissu de l’historiographie bretonne et son premier essai marquant est le rétablissement de « la vérité » à propos de la légende de Conan Mériadec, roi de la Bretagne romaine, dont Alain Bouchart avait « historisé » la fable (que Dom Lobineau avait déjà passablement attaquée) .
Conseillé par des amis, il se présente à l’École des chartes, y étudie de 1849 à 1852 et en sort major de sa promotion. Il a appris la paléographie et possède désormais suffisamment d’instruments et maîtrise assez d’approches critiques pour l’examen impartial qu’il souhaite mener des sources de l’histoire bretonne. Pendant ses études, il a eu accès aux manuscrits bénédictins des Blancs-Manteaux et a fait une ample moisson documentaire qui lui servira par la suite.
De retour en Bretagne, à Nantes, de 1853 à 1859, il dirige les archives de la ville. On lui demande alors d’étudier les documents de la Cour des Comptes ainsi que le trésor des chartes des ducs de Bretagne, ce qu’il fait avec beaucoup d’exactitude.
Ses amis le décrivent alors comme un bon vivant : « Ce paléographe bien renté, écrit ainsi un témoin des années nantaises, tenait table ouverte. […] Il ne continuait à boire que du cidre, mais pour ses convives, le bordeaux, le bourgogne et le champagne coulaient à flot ». Derrière cette affabilité, il est cependant un personnage très autoritaire, convaincu de sa supériorité lorsqu’il s’agit d’histoire et qui ne manque pas d’arrogance vis-à-vis de ceux qu’il juge piètres historiens.
Sa fortune personnelle lui permet de consacrer temps et argent à ses recherches. Son esprit d’entreprise, une puissance de travail imposante font que, très vite, il devient l’élément moteur, la personnalité déterminante de l’organisation de la recherche historique bretonne : il soutient et dirige quasiment la section d’archéologie de l’Association bretonne jusqu’à sa disparition en 1858. Il est de tous les congrès, de toutes les manifestations, de toutes les sociétés savantes départementales. Il fonde la Société archéologique de la Loire-Inférieure, est membre fondateur de la Société Archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine, dont il est Président de 1863 à 1890. Il est en outre membre correspondant de la Société archéologique du Morbihan (1858), membre de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord (1868). Il sera de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres (1869), de l’Association artistique et littéraire de Bretagne, membre non-résident du Comité des travaux historiques au ministère de l’instruction publique (1875), de la Société française d’archéologie, de l’Institut des Provinces…
En 1874 il relancera l’Association bretonne, supprimée sous le second empire, après avoir participé très activement au Congrès Celtique qui s’était déroulé à Saint-Brieuc en octobre 1867…
Un banquet sera organisé en son honneur à Nantes le 6 février 1890 et tous ses admirateurs s’empresseront de lui rendre hommage.
Cette activité débordante est pour lui le moyen de faire passer le message auquel il croit : les méthodes et la rigueur de l’historien moderne. Très marqué par les historiens allemands, il écrit ainsi en 1867 : « Pour se servir des grands mots que l’Allemagne a mis en usage, le caractère essentiel de la méthode historique moderne, c’est l’alliance intime de l’analyse et de la synthèse. » En d’autres termes, rechercher le détail précis et vrai sans perdre de vue l’ensemble et les grandes lignes de l’histoire.
C’est lui qui crée en 1857, à Nantes, La Revue de Bretagne et de Vendée dans laquelle il publie un nombre incalculable d’articles qui lui serviront à commencer une grande synthèse de ses travaux à la fin de sa vie. Il veut aussi rendre accessibles les documents rares, les manuscrits concernant non seulement l’histoire mais aussi la littérature et il est l’instigateur en 1877 de la Société des bibliophiles bretons. On s’adresse à lui avant chaque événement qui touche non seulement à l’histoire mais plus généralement à la vie culturelle de la province, car il ne se limite pas à l’histoire au sens propre du terme, la littérature l’intéresse tout autant, il écrit des monographies sur les auteurs bretons passés et insuffisamment connus comme Poullain de Saint-Foix et cherche à aider les écrivains contemporains chez qui il décèle un vrai talent. Ainsi recevant l’« Élégie de la Bretagne » de Brizeux, le testament littéraire de l’auteur de Marie, malade et qu’on commence à oublier, il écrit en janvier 1857 pour sa Revue de Bretagne et de Vendée à laquelle le poète s’est adressé : « En imprimant les vers qu’on va lire, nous croirions faillir au devoir, si nous manquions d’exprimer notre reconnaissance au poète éminent qui a bien voulu en gratifier notre revue. C’est une consécration pour notre œuvre d’avoir été jugée digne de prêter, avant toute autre, à l’oreille et au cœur de la Bretagne, ce cri de haute poésie et d’ardent patriotisme. » Ni flagornerie, ni formule adressée poliment et traditionnellement à un auteur encore réputé dans cette déclaration, mais l’émotion d’un homme vraiment honoré de cette marque de confiance accordée par celui qu’il considère comme un grand écrivain breton : La Borderie est en effet un « ardent » patriote.
Il songe à la création d’une université de Bretagne, et, sollicité par le doyen Antoine Dupuy, il accepte entre 1890 et 1894 d’être chargé de cours libre, de devenir ce que les universitaires allemands appellent un « Privatdozent » à la faculté des lettres de Rennes, en dépit de son peu d’affinité avec un enseignement d’état. Il crée ainsi le premier cours d’histoire de Bretagne dans cette université.
Pourtant, cet homme qui a pour ambition de moderniser, de renouveler les études bretonnes, cet esprit curieux, ouvert à tout ce qui peut faire avancer sérieusement la recherche, néglige certaines sciences indispensables à l’historien moderne qu’il souhaite être et donner en exemple : la linguistique, la toponymie, l’onomastique, par exemple. Chose plus étonnante – Renan ne cachera pas sa stupéfaction – la langue bretonne lui est quasiment inconnue. Enfin, ce créateur de sociétés archéologiques délaisse étrangement l’archéologie ou ne l’associe guère à ses travaux.
D’autre part, ses positions idéologiques – il est un catholique fervent et un conservateur affirmé – l’amènent à certaines inconséquences : il prône l’approche critique des documents, mais se refuse à mettre en question les vies de saints en tant que sources historiques fiables ! Très lié à l’Église et à Mgr Saint-Marc, il cautionne par exemple le lancement de la Semaine religieuse du diocèse de Rennes ou fonde le Comité de l’enseignement libre (1868).
Si son attachement religieux lui fait accepter comme nécessairement vraies certaines des pires fables de l’hagiographie, en revanche, il n’accorde aucun intérêt au bardisme païen, lui refusant tout lien avec le christianisme, toute influence. Il est en quelque sorte le représentant en Bretagne de cette recherche convaincue de la supériorité de la méthode scientifique, mais qui, par respect religieux, évite une critique absolue. Son positivisme est un positivisme qui s’arrête au seuil des questions religieuses et dogmatiques. Sa monumentale Histoire de Bretagne en six volumes (qu’il ne put malheureusement achever, mais que termina son disciple – sur ses notes, mais dans un esprit moins « national » – Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé 1906-1913) est ainsi largement dépassée sur plusieurs plans et ne peut plus être lue sans un regard critique (« Une ingénieuse combinaison de Frère Albert et de Dom Lobineau dressée par un paléographe », écrira François Duine en 1918) ! La Borderie est en effet marqué par un solide patriotisme breton indissociable de sa profession de foi catholique et conservatrice. Il a d’ailleurs reçu mission de Mgr Bouché d’écrire cette histoire de la Bretagne « complète, définitive » ! Son idée a été de montrer que les Bretons forment une population originale en ses débuts, qui est passée par quatre périodes successives : la formation, l’épanouissement, le déclin avant de rejoindre « le fleuve immense et splendide de l’histoire de France ». À son avis, à l’origine, ce sont les saints qui sont à la base de tout : défrichements, agriculture, médecine des corps et des âmes, amélioration des conditions de vie. En bref, ils ont apporté la civilisation… L’invasion bretonne en Armorique menée par les saints et les chefs est pour lui un grand thème racial et religieux, la volonté d’un peuple de reconstituer sur une terre quasiment vide un ordre social, une civilisation (alors qu’on considère sans doute plus justement que les « envahisseurs » sont plutôt venus en Armorique en quête de ce qui reste de la Pax Romana).
Avec Nominoé débute la période d’épanouissement et ce roi qui aurait su garder une indépendance de fait exerce une véritable fascination sur l’historien qui oublie parfois toute prudence critique, confondant mythe et réalité.
Le déclin breton aurait eu pour point de départ le traité d’union et il considère enfin que, depuis la nuit du 4 août, où la constitution bretonne a été définitivement abandonnée, il n’y a plus d’avenir breton pour la Bretagne. La seule attitude possible est éminemment conservatrice : il faut en quelque sorte rester sur place, sauver ce qui peut encore être sauvé, ralentir voire arrêter la chaîne de l’évolution : « L’esprit distinctif de la Bretagne, c’est son esprit de stabilité, sa force incalculable de résistance. Résister au mal, à l’injustice, à l’oppression, surtout à l’invasion étrangère qui attaque le sol et le cœur de la patrie. »
Un second banquet lui sera offert à Rennes en janvier 1897 pour marquer la parution du premier volume de ce « grand œuvre », dont Camille Le Mercier d’Erm dira qu’il est « l’un des plus beaux monuments élevés à la gloire de notre patrie ».
En 1867, hostile à l’Empire, il s’oppose au « despotisme ministériel » comme les notables bretons du XVIIIe siècle ; en 1871, par hostilité à la République, il se fait élire à l’Assemblée nationale (sur une liste monarchiste ; il siégera à droite jusqu’en 1876) et, conseiller général de Vitré (1864-1871), il met constamment en avant ses convictions catholiques. En 1873, rapporteur de la Commission d’enquête sur les actes du Gouvernement de la Défense Nationale, en cette qualité il dénonça avec véhémence à la tribune du Palais Bourbon l’attitude des Gambetta, Chanzy ou Freycinet à propos de la déplorable affaire du Camp de Conlie et de la bataille du Mans. Son discours devait inspirer le célèbre pamphlet de Léon Bloy. On rapporte qu’à l’Assemblée, il manifestait en toute occasion son opposition à la République (mais il n’avait – non plus – jamais vraiment accepté l’Empire). Quel que fût le sujet abordé par un orateur de la Gauche, il lançait régulièrement ce cri : « Et la Commune ? ». Il votera contre l’amendement Wallon le 30 janvier 1875 qui instaure l’élection du Président à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale, officialisant ainsi la nature républicaine du nouveau régime, mais s’abstiendra dans le vote sur les lois constitutionnelles.
Il n’a de cesse de défendre ce qu’il croit être l’honneur des Bretons. Il rêve en réalité de l’ancienne Bretagne des États : vivre dans une Bretagne aussi décentralisée que possible où rien ne changerait. Pour lui la nation bretonne se situe dans le passé et pas dans l’avenir. Il participe ainsi à l’exaltation régionaliste des années 80 commune à bien des régions de France, tout en insistant pour sa part sur la spécificité de la nation bretonne. Il est ambigu dans ses positions, parfois proche d’un autonomisme qui ne s’avoue pas.
Auteur de quantité d’ouvrages et d’articles d’histoire, d’histoire littéraire, de biographies, il laisse un grand nombre de manuscrits inachevés, qui, pour la plupart, paraîtront après sa mort survenue le 17 février 1901 à Vitré.
François Labbé, tous droits réservés
[1] En 1863, avec Luzel, La Borderie fera publier un manuscrit de Le Huërou, Histoire de la constitution anglaise depuis l’avènement de Henri 8. jusqu’à la mort de Charles 1er. Il en rédige la préface.
Pour ouvrir le .PDF, cliquez ---------->
------ ¤¤¤¤¤¤ ------

LE STETHOSCOPE du Dr LAËNNEC
Le stéthoscope (du grec stêthos (στῆθος), "poitrine", et scope du grec ancien "skopein" (σκοπεϊν), « observer ») est un instrument médical acoustique, utilisé pour l'auscultation, c’est-à-dire l'écoute des sons internes au corps humain.
Formation
Suivant l'exemple de ce dernier, LAËNNEC entame des études de médecine. En 1800, il est étudiant à Paris sous la direction de Jean-Nicolas CORVISART à l'hôpital de la Charité et d’autres professeurs comme Guillaume DUPUYTREN. Il est reçu docteur en médecine en 1804. Il pratique ensuite l'anatomie pathologique avec Gaspard Laurent BAYLE. Il étudie les maladies à partir des lésions constatées à l’autopsie et, en particulier, la cirrhose.
Activité professionnelle
En 1816, il est nommé à l’hôpital Necker. Il s’intéresse aux maladies pulmonaires et identifie ses malades en utilisant largement la technique de percussion décrite pour la première fois par le médecin autrichien Léopold AUENBRUGGER en 1761 dans son ouvrage Inventum Novum et diffusée par Corvisart, une méthode qui renseigne sur l’état d’un organe par l’écoute du bruit rendu par la frappe des doigts au niveau de ce dernier. C’est dans ce cadre qu’il crée selon la légende le 17 février 1816 le stéthoscope, d’abord un simple rouleau de papier ficelé qu’il appelait « pectoriloque » et qui permettait d’éloigner l’oreille du médecin de son patient pour des raisons de pudeur, stéthoscope qu’il ne tarde pas à perfectionner en cylindre démontable et en buis et dont l’usage est attesté en mars 1817 sur les feuilles des malades à l’Hôpital Necker. Il fonde ainsi une nouvelle pratique qui permet d’analyser les bruits corporels internes et de les relier à des lésions anatomiques, ce qui se révélera particulièrement utile pour le diagnostic des maladies respiratoires, dont la phtisie ou tuberculose. En février 1818, il présente ses découvertes dans un discours à l’Académie de Médecine, et en 1819, il publie son Traité d’auscultation médiate où il classe les bruits émis dans le thorax. En 1822, il est titulaire de la chaire de médecine pratique du Collège de France.
René-Théophile-Marie-Hyacinthe LAËNNEC, né le 17 février 1781 à Quimper, meurt le 13 août 1826 (à 45 ans) à Douarnenez dans son manoir de PLOARE,
Il est également l'inventeur du stéthoscope
L’histoire
Par un après-midi d'octobre 1815, il passe sous les guichets du Louvre. Des enfants jouent dans la cour parmi des décombres. Un gamin gratte l'extrémité d'une longue poutre avec la pointe d'une épingle. À l'autre extrémité, l’oreille collée à la poutre, les enfants recueillent les sons, se bousculent pour entendre, et rient de la découverte. Il s'arrête devant les enfants qui venaient de lui donner la réponse au problème qu'il se posait depuis longtemps.
Parvenu au chevet d'une jeune cardiaque, il demande une feuille de papier à lettre, le roule en cylindre, appuie une extrémité contre la poitrine de la patiente et l'autre contre sa propre oreille. Et voici que le double bruit du cœur et celui de la respiration lui parvient avec netteté.
Le stéthoscope est inventé, selon la légende, le 17 février 1816 en France, par le docteur René LAËNNEC. Il ne s'agissait alors que d'une simple liasse de papiers roulés, permettant d'éloigner l'oreille du médecin de son patient pour des raisons de pudeur, mais aussi d'efficacité. Il crée ainsi l'auscultation médiate par opposition à l'auscultation immédiate où il avait la tête collée à la poitrine du patient. Sa première description écrite de son système remonte au 8 mars 1817. LAËNNEC en construisit secondairement plusieurs modèles en bois.
Le modèle en a été amélioré vers 1830 par Pierre PIORRY qui construisit un adaptateur en ivoire du côté auriculaire. Vers la même époque, un tube flexible relie le pavillon à l'écouteur mais le modèle rigide va encore persister quelques décennies.
Le stéthoscope biauriculaire (pour les deux oreilles) a été imaginé dès 1829 mais construit seulement en 1851. Le tube était en caoutchouc mais cette solution s'avéra fragile et dut être abandonnée. Un second modèle, plus rigide, vit le jour en 1852 à base de tubes métalliques.
Vers 1870, des stéthoscopes différentiels apparaissent : deux pavillons, montés chacun sur un tube et connectés à une oreille, devaient permettre de comparer l'auscultation à deux endroits différents.
En 1961, le Dr David LITTMANN créa le stéthoscope contemporain avec son double pavillon réversible, qui reste toujours utilisé de nos jours.
Le 1er stéthoscope du monde est aujourd'hui à Nantes car René LAËNNEC qui en est l’inventeur a vécu à Nantes, place du Bouffay notamment de 1788 à 1800. L’un de ses descendants a légué une partie de ses objets et manuscrits originaux, dont le célèbre stéthoscope à l’école de médecine. Aujourd’hui, une salle d’exposition les met enfin en valeur au dernier étage de la faculté de Pharmacie.
___________________ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____________________


René LAËNNEC est fils et petit-fils d'avocats. Son grand-père, Michel Alexandre LAËNNEC, est maire de Quimper de 1763 à 1765.
Son père Théophile-Marie LAËNNEC (1747-1836), avocat et magistrat quimpérois, parle le breton et René lui-même l'apprend, le parle couramment, et l'utilise dans sa correspondance avec son père. Par sa mère, Michelle GUESDON, il était apparenté à Anne-Marie AUDOUYN de POMPERY, la "Sévigné cornouaillaise" dont il était le cousin et qui le reçut maintes fois dans son château de Couvrelles. LAËNNEC avait pour grand-oncle Dom Maurice de BEAUBOIS, auteur d'Une histoire de la Bretagne[2].
Sa mère, Michelle, meurt en 1786 de la tuberculose (elle est inhumée le 15 décembre 1786 dans le cimetière de l'église Saint-Mathieu de Quimper). Son père, alors lieutenant au ministère de la Marine à Quimper, est incapable de s'occuper de lui. Après avoir été confié à un oncle, recteur à Elliant, René LAËNNEC est, en 1797, recueilli par Guillaume François LAËNNEC, un autre de ses oncles, médecin à Nantes, professeur et directeur de l'école de médecine, qui avait été recteur de l'université de Nantes[] avant sa suppression au début de la Révolution.


Publié le 30 août 2017
Bertrand du Guesclin
Bertrand du Guesclin, né vers 1320 au château de la Motte-Broons, près de Dinan et mort le 13 juillet 1380 devant Châteauneuf-de-Randon, est un noble breton, connétable de France et de Castille.
Enfance
Comme il est d'usage, Bertrand est placé en nourrice et est élevé parmi des paysans jusqu'à l'âge de cinq ans. Le portrait peu flatteur qui nous est laissé par les historiens le décrit « petit », « les jambes courtes » et « noueuses », « les épaules démesurément larges », « les bras longs », « une grosse tête ronde et ingrate », « la peau noire comme celle d'un sanglier ». Sa laideur (la Chanson de Bertrand du Guesclin du trouvère Cuvelier dit de lui qu'il fut « l'enfant le plus laid qu'il y eût de Rennes à Dinan ») et sa brutalité lui valent l'opprobre parental. Bien qu'il soit l'aîné d'une fratrie de six enfants, sa mère donne la préférence à ses deux frères cadet et puîné, et son père le traite assez mal, refusant de le former à la chevalerie : la chronique de Cuvelier dit de ses parents qu'ils « le détestaient tant, que souvent en leur cœur ils désiraient qu’il fût mort ou noyé dans l’eau courante ». Vers l'âge de six ans, il gagne néanmoins le respect de sa mère et ses cadets : selon les chroniques médiévales de l'époque (qu'il faut lire de nos jours avec une certaine circonspection à cause de leur tendance à embellir les actions des personnages — et de leurs proches — commanditaires ou protecteurs du chroniqueur, comme les Chroniques de Froissart[]), relégué comme à son habitude dans un coin de la pièce lors d'un repas familial en l'absence du père, il explose de colère et bouscule ses frères pour prendre sa place d'aîné sur le banc. Sa mère s'apprête à le punir quand il renverse la lourde table mais une femme juive convertie, versée dans la chiromancie et venue pour raconter la bonne aventure, prédit la gloire à ce fils belliqueux. Bertrand est désormais traité avec les égards dus à son rang. Selon un vers de Cuvelier contant que « lire ne savait, ni écrire, ni compter », nombre d'historiens en ont déduit que Du Guesclin était illettré, ce qui est peu vraisemblable, ses parents lui ayant certainement donné une éducation nobiliaire digne de leur statut.
Le premier tournoi
Selon les chroniques de l'époque, il se fait remarquer dès son enfance par sa force, son habileté dans les exercices du corps et ses goûts belliqueux avec ses compagnons de jeunesse, des paysans roturiers. Bagarreur, il se sent la vocation de guerrier. Alors qu'il s'est enfui (ou a été chassé par ses parents ?) chez son oncle (Bertrand du Guesclin, seigneur de Vauruzé) à Rennes, il assiste à un tournoi sur la Place des Lices de cette ville le 4 juin 1337, où il a interdiction de participer : un de ses cousins, vaincu, quitte la lice et lui prête son équipement. Toujours selon les chroniques de l'époque, Bertrand défait, masqué, douze ou quinze chevaliers selon les versions, avant de refuser de combattre son père en inclinant sa lance par respect au moment de la joute, à la grande surprise de l'assemblée qui se demande qui est ce chevalier sans blason. Un seizième chevalier qui le défie parvient à faire sauter la visière de son heaume. Robert Du Guesclin découvre le visage de son fils : ému et fier, il s'engage à l'armer grâce à une collecte réalisée auprès de ses proches. Bertrand va pouvoir ainsi gagner sa réputation d’excellent tournoyeur.
Guerre de succession de Bretagne
Il commence à signaler sa bravoure dans les guerres que se livrent Charles de Blois et les comtes de Montfort, Jean II et son fils Jean III, pour l'héritage du duché de Bretagne. Il se fait remarquer aussi dès le début de la guerre de Cent Ans, notamment en 1354 en prenant par ruse le château de Grand-Fougeray et en 1357 en participant à la défense de Rennes assiégée par Henry de Grosmont, duc de Lancastre. Guesclin ayant gagné le respect de la noblesse à la pointe de son épée, le chevalier Alacres de Marès, dépendant du bailliage de Caux, l'adoube chevalier au château de Montmaurin dans les Ifs en 1357. Il prend alors pour devise « Le courage donne ce que la beauté refuse ». Il est nommé capitaine de Pontorson et du Mont Saint-Michel sur recommandation de Pierre de Villiers. Il promet qu'il ne trouveroit jamais occasion qu'il ne chargeast les Anglois quelque part qu'il les renconstrat.
Soutenant Charles de Blois, époux de Jeanne de Penthièvre, prétendante à la couronne ducale, c'est en guerroyant plusieurs années dans la forêt de Paimpont et ses alentours qu'il devient celui que les Anglais vont craindre : Le Dogue noir de Brocéliande.
La bataille d'Auray, d'après la Chronique de Bertrand Du Guesclin par Cuvelier.
En 1360, il est lieutenant de Normandie, d'Anjou et du Maine puis, en 1364, capitaine général pour les pays entre Seine et Loire et chambellan de France.
Alerté par Guillaume de Craon, seigneur de Sablé, qu'une troupe anglaise dirigée par Hugues de Calveley se dirige vers Juigné-sur-Sarthe en janvier 1361, ce dernier se propose de se joindre à lui pour les attaquer. Du Guesclin se retrouve isolé et est fait prisonnier. Il retrouve sa liberté après le paiement d'une rançon de 30 000 écus. Hugues de Calveley deviendra par la suite l'un de ses lieutenants en Espagne.
Du Guesclin s'illustre en 1364 lors des prises de Rolleboise, de Mantes et de Meulan et célèbre l'avènement de Charles V en avril 1364, en remportant la bataille de Cocherel contre l'armée du roi de Navarre. Il prend ensuite Valognes où son fidèle Guillaume Boitel, qui commande l'avant-garde, joue le rôle déterminant. Il reçoit le comté de Longueville en Normandie.
Après ces victoires, il vole de nouveau au secours de Charles de Blois en Bretagne ; mais, en septembre 1364, à la bataille d'Auray, malgré tous ses efforts, son parti est battu : il est fait prisonnier par John Chandos, chef de l'armée anglaise. Sa rançon est de 100 000 livres. Le roi de France paie 40 000 livres, Guy XII de Laval répond du reste.
Guerre civile espagnole
En 1365, à la demande du roi de France, il délivre le royaume des Grandes compagnies, groupes de mercenaires qui ravageaient les provinces. Il les persuade de participer à la première guerre civile de Castille aux côtés d'Henri de Trastamare qui dispute à Pierre le Cruel le trône de Castille. Avec l'aide de son fidèle lieutenant Guillaume Boitel qui dirige son avant-garde, il s'y couvre de gloire, et déjà il a anéanti le parti de Pierre le Cruel, lorsque celui-ci appelle à son secours le Prince Noir, gouverneur de Guyenne.
Du Guesclin est défait par les Anglais du Prince Noir à la bataille de Nájera, livrée contre son avis (1367). Il est fait prisonnier et libéré sur parole grâce à l'insistance de Hugues de Calveley auprès du Prince Noir. Du Guesclin collecte des fonds auprès de ses amis pour payer la rançon de ses officiers et reconstituer ainsi son armée avant de payer sa propre rançon qu'il a lui-même fixée d'abord à 100 000 livres puis à 60 000 livres, ayant compris que le prince noir ne pouvait accepter qu'il vaille si cher. L'épouse du Prince Noir, qui admire Du Guesclin, verse 10 000 livres à son mari sur sa cassette personnelle et le solde est à nouveau payé par Charles V. En 1369, Du Guesclin retourne en Espagne où il remporte la bataille de Montiel contre Pierre le Cruel et l'armée des Sarrazins venus du Maroc. Il rétablit Henri sur le trône et, en récompense de ses actions en Espagne, il est fait duc de Molina.
Connétable de France
En octobre 1370, revenu en France, Du Guesclin est fait connétable de France par Charles V. Sa grande entreprise va être d'expulser les Anglais. Contrairement aux habitudes de la chevalerie française, il ne procède pas par grandes campagnes avec tout l'ost français, mais préfère reconquérir méthodiquement des provinces entières, assiégeant château après château. Il va chasser les Anglais de la Normandie, de la Guyenne, de la Saintonge et du Poitou.
Bien souvent, le siège ne dure pas, l'issue en étant accélérée par un assaut victorieux ou plus souvent encore par une ruse. Pour libérer Niort de la domination anglaise, il utilise un subterfuge : il fait revêtir à ses soldats l'uniforme anglais. L'ennemi, confiant, ouvre les portes de la ville et l'armée de Du Guesclin s'en empare.
Georges Minois, historien du Moyen Âge, qualifie ainsi les victoires et la reconquête menées par Bertrand Du Guesclin : « Certes, il ne conduit qu'une petite troupe de quelques centaines d'hommes, mais il obtient avec eux des résultats plus importants qu'avec une grosse armée, coûteuse, lourde, encombrante et lente. » Cette tactique victorieuse est menée pour trois raisons majeures :
-
premièrement, Charles V est avare de son argent, le connétable doit se contenter de peu de moyens ;
-
deuxièmement, cela lui permet de tirer le maximum de ses maigres effectifs : il a obtenu plus de résultats en un mois de campagne (décembre 1370) que Robert Knollys, le meilleur capitaine d'Édouard III, en six ;
-
troisièmement, ce type de guerre, guerre d'embuscades, autrement dit, guérilla avant l'heure, est la mieux adaptée aux circonstances, puisqu'il s'agit de reprendre des châteaux dispersés, qui commandent routes et carrefours ; son petit groupe, mobile, souple, avec un noyau d'élite breton, bien soudé, anticipe les actions des « commandos » du XXe siècle en frappant vite, à l'improviste, en restant insaisissable, en entretenant l'insécurité chez l'ennemi et en le décourageant petit à petit. Cette stratégie s'avère très payante.
En 1374, il combat à La Réole. La même année il se marie avec Jeanne de Laval dans la chapelle du château de Montmaurin et en devient propriétaire par alliance jusqu'en 1380. En outre, son épouse lui apporte en dot le château de Montsabert en Anjou. Le château de Montsûrs est dès lors sa demeure, et il y réside dans les périodes hors-guerre. Il y traitera du mariage de sa nièce Marie d'Orange, avec Jean, vicomte de Vendôme.
En 1376, il reçoit la seigneurie de Pontorson en Normandie. Charles V, ayant en 1378 fait prononcer la confiscation du duché de Bretagne, occupé par ses officiers depuis 1373, le duc Jean IV étant en exil à Londres, provoque une fronde nobiliaire bretonne et le rappel du duc Jean IV de Bretagne exilé en Angleterre. L'inaction de Du Guesclin lors du débarquement de Jean IV à Dinard le fait soupçonner de trahison. Il est indigné d'un tel soupçon, selon la version non établie de la chronique de Jean Cabaret d'Orville il aurait même renvoyé aussitôt au roi son épée de connétable et voulu passer en Espagne auprès d'Henri de Trastamare. Ayant retrouvé la confiance du roi grâce à l'entremise du duc d'Anjou, il retourne dans le Midi pour combattre encore les Anglais. En 1378, il participe à la campagne contre la Bretagne, avec son cousin Olivier de Mauny — chevalier banneret, seigneur de Lesnen et pair de France, qui fut nommé capitaine général de Normandie et chambellan de Charles V en 1372.
En 1380, il combat contre les Grandes compagnies en Auvergne et le sud du Massif central, et il met le siège devant Châteauneuf-de-Randon (Gévaudan) : après plusieurs assauts terribles, la place promet de se rendre au connétable lui-même, si elle n'est pas secourue dans 15 jours. Du Guesclin, pris d'une forte fièvre, meurt dans l'intervalle. La tradition attribue son décès à la consommation d'eau glacée pendant les chaleurs de l'été, une allégation commune à cette époque. Il aurait étanché sa soif à la fontaine de la Cloze / Glauze (selon les sources), visible au hameau d'Albuges. Le jour de son décès, le 13 juillet 1380 le gouverneur vient, la trêve expirée, déposer en hommage les clefs de la place sur son cercueil. Son corps est déposé à Saint-Denis.
La reconnaissance politique que le roi Charles V veut témoigner à son connétable vaut à Du Guesclin le privilège d'une quadruple sépulture. La partition de son corps (dilaceratio corporis, « division du corps » en cœur, entrailles, chairs et ossements) avec des sépultures multiples permet ainsi la multiplication des cérémonies (funérailles du corps, la plus importante, puis funérailles du cœur, des chairs et funérailles des entrailles) et des lieux (avec un tombeau de corps, de cœur, de chairs et un tombeau d'entrailles) où honorer le défunt. Bertrand Du Guesclin est probablement le seul défunt au monde à posséder quatre tombeaux.
Du Guesclin a souhaité par testament que son corps repose en Bretagne après sa mort. Au cours d'un arrêt du cortège funèbre au Puy-en-Velay, le corps est éviscéré et subit un premier embaumement, les viscères étant inhumées en l'église du couvent des Dominicains. Arrivé à Montferrand quelques jours plus tard, on s'aperçoit qu'un nuage de mouches obscurcit le cortège, suivant de près la charrette sur laquelle le corps est déposé. En l'absence des embaumeurs royaux, l'opération d'embaumement a échoué : maladresse des praticiens ? Chaleur estivale trop forte ? Toujours est-il qu'on décide de faire bouillir le corps dans une marmite de vin aromatisé d'épices pour détacher les chairs du squelette, technique funéraire d'ex carnation connue sous le nom de mos Teutonicus, l'« usage teuton ». Les chairs sont inhumées au couvent des Cordeliers de Montferrand.
Le squelette et le cœur poursuivent leur route vers la Bretagne. Passant outre les dernières volontés du défunt, le roi Charles V décide de faire enterrer les ossements de son connétable dans la basilique royale de Saint-Denis, aux pieds même du tombeau qu'il se fait alors préparer pour lui-même.
Son cœur seul parvient en Bretagne où il est déposé sous une dalle au couvent des Jacobins à Dinan. En 1810, la pierre tombale et l'urne contenant le cœur sont transférées dans l'église Saint-Sauveur de Dinan
Sa sépulture à Saint-Denis (sous un gisant en armure avec ses deux solerets, genouillères et cubitières, un surcot et un baudrier sur lequel est attaché d'un côté une dague anachronique, de l'autre côté l’épée dans son fourreau de cuir et l’écu en métal doublé de cuir et gravé avec ses armoiries, l'œil gauche percé, marque d’un coup de lance reçu en combattant les Anglais en 1364[29]), comme celles de la plupart des princes et dignitaires qui y reposaient, est profanée par des révolutionnaires en 1793, comme l'est aussi le tombeau contenant ses chairs bouillies (à Montferrand).
Quant au tombeau qui contient ses entrailles (église Saint-Laurent, au Puy), il échappe à la profanation : l'urne est mise en dépôt à la mairie en vue de lui donner une sépulture laïque puis est finalement replacée dans l'église Saint-Laurent avec son contenu ; ils y demeurent toujours.
Trois des quatre tombes sont encore visibles et ornées de monuments, celle de Montferrand ayant disparu lors de la Révolution française. Les gisants de Saint-Denis et celui du Puy permettent d'observer un personnage et un visage apparemment sculptés à la ressemblance du sujet, par ailleurs connu par des descriptions physiques et plusieurs miniatures contemporaines, insistant toutes sur la laideur et la pugnacité que révélait son visage.
Postérité
Du Guesclin laisse une image partagée et même contradictoire : il est ainsi considéré, selon les sources, soit comme un héros à la loyauté absolue, soit comme un traître.
Il doit son statut de héros au fait qu'il ait de son vivant soigné son image et travaillé à faire, et faire connaître, sa propre réputation, en comptant notamment dans son entourage Cuvelier, un trouvère qui composa sur lui une biographie rimée. Il le doit également à la mythographie de sa mort (telle la ballade Sur le trépas de Bertrand du Guesclin d'Eustache Deschamps) ou à la description dans les Chroniques de Froissart de l'ascension sociale que sa naissance ne lui laissait espérer. Les poètes du XIVe siècle comme Cuvelier ou Deschamps l'adjoignent comme dixième héros aux neuf Preux légendaires. Cette figure héroïque est également diffusée par la propagande nationaliste française du XIXe siècle avec des historiens comme Ernest Lavisse, Albert Malet (il est ainsi présenté comme précurseur de Jeanne d'Arc en cristallisant le sentiment national du peuple français qui s'est construit autour du roi contre les Anglais) et est maintenue par des historiens du XXe siècle comme Jean Duché.
Son image de traître a une double origine :
-
une origine historique : de son vivant, il subit l’opprobre des partisans de Jean de Montfort qui lui reprochent de soutenir Charles de Blois; lors de l'épisode du retour d'exil de Jean IV de Bretagne en 1379 (la chanson An Alarc'h le qualifie expressément de traître)
-
une origine idéologique : les nationalistes bretons du XXe siècle le considèrent comme un traître à la fois en raison de cet événement, mais aussi plus généralement pour son engagement auprès de la France. Le Mouvement ouvrier social-national breton, groupuscule collaborationniste, a détruit à coup de marteau la statue du Connétable de France se trouvant dans le Jardin des plantes de Rennes en 1941. L'organisation indépendantiste du Front de Libération de la Bretagne fait également sauter la statue de Du Guesclin à Broons le 12 février 1977.
Si la première origine de cette qualification de traître est purement partisane (Montfortistes contre Blésistes), la seconde origine est totalement anachronique : l'historien Louis Élégoët fait remarquer qu'il s'agit de la transposition, par les nationalistes, de leur vision moderne du concept de nation, alors que Du Guesclin vit à une époque où un système féodal est en place : ayant pris le parti de Charles de Blois lors de la guerre de Succession de Bretagne, il se positionne en vassal du seigneur de celui-ci, le roi de France Charles V, et, contrairement à nombre d'autres seigneurs de l'époque, ne changera jamais d'allégeance au cours de sa vie en ayant fait une question de principe.
Entre le petit nobliau de province qui se constitue une bande de partisans dans la forêt de Paimpont et le « bon » connétable à la tête de l'armée du roi Charles V le Sage (ce roi peu fait pour la guerre qui a rétabli la paix grâce à des chevaliers comme Du Guesclin), Bertrand Du Guesclin constitue ainsi dans la mentalité collective une image « à mi-chemin entre un Robin des Bois breton et un Bayard médiéval ».
Unions et descendance
On lui connaît deux mariages, qui ne laissent pas d'enfants :
-
Il est l'époux, en premières noces, probablement en 1363 à Vitré, de Tiphaine Raguenel (morte en 1373), fille de Robin III Raguenel, seigneur de Châtel-Oger, héros du combat des Trente, et de Jeanne de Dinan, vicomtesse de La Bélière ;
-
Il épouse, en secondes noces, le 21 janvier 1374 au château de Montmaurin aux Ifs, Jeanne de Laval (morte après 1385), fille de Jean de Laval (mort en 1398), et d'Isabeau de Tinténiac. Après son veuvage, en 1380, Jeanne de Laval se remarie, le 28 mai 1384, avec Guy XII de Laval (mort en 1412), sire de Laval.
De sa relation avec Doña de Soria, dame de la cour de la reine Jeanne de Castille, on suppose qu'il a trois enfants :
-
Olivier Du Guesclin (né vers 1366), qui sera l'ancêtre des marquis de Fuentes ; Bertrand Torreux Du Guesclin ; Michel Du Guesclin.
Armoiries
« D'argent à l'aigle bicéphale éployée de sable becquée et membrée de gueules, à la cotice du même brochant sur le tout. »
La cotice (ou bâton en bande — quasi-équivalent) est une bande réduite en largeur et était utilisée en général comme brisure pour les cadets. Le père de Bertrand représente une branche cadette de la famille Du Guesclin.
------ ¤¤¤¤¤¤ ------

Le Dogue noir de Brocéliande
Fils aîné des dix enfants de Robert II du Guesclin (v. 1300-1353), seigneur de la Motte-Broons, et de son épouse Jeanne de Malesmains (morte en 1350), dame de Sens-de-Bretagne, Bertrand du Guesclin est issu d'une rustique seigneurie de la petite noblesse bretonne. Les Guesclin font en effet partie des familles nobles de Bretagne, mais Robert du Guesclin n'appartient qu'à la branche cadette de la famille (la branche aînée vit au château du Plessis-Bertrand et au château de la Motte-Jean) et occupe un modeste manoir à la Motte-Broons.


Publié le 30 août 2017
Ernest Renan
Ernest Renan dans les années 1870 et sa maison natale à Tréguier.
Nom de naissance : Joseph Ernest Renan
Naissance : 28 février 1823 à Tréguier, Côtes-du-Nord, France
Décès : 2 octobre 1892 (à 69 ans) à Paris, Seine, France
Activité principale : Écrivain, philologue, philosophe, historien
Distinctions : Grand-officier de la Légion d'honneur
Son intérêt pour sa Bretagne natale a été constant
de L'Âme bretonne (1854) à son texte autobiographique
Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883).
Biographie détaillée
Ernest Renan naît le 28 février 1823 à Tréguier dans une famille de pêcheurs ; son grand-père, ayant acquis une certaine aisance, y a acheté une maison où il s'est établi ; son père, capitaine d'un petit navire et républicain convaincu, a épousé la fille de commerçants royalistes de la ville voisine de Lannion. Sa mère n'est qu'à moitié bretonne, ses ancêtres paternels étant venus de Bordeaux : Renan confessera qu'en sa propre nature, le Gascon et le Breton ne cessent de se heurter. Toute sa vie, Renan se sentira déchiré entre les croyances politiques de son père et celles de sa mère. Il a cinq ans lorsque son père meurt, sa sœur Henriette, de douze ans son aînée, devient alors le chef moral de la famille. Tentant en vain d'ouvrir une école pour filles à Tréguier, elle part pour Paris comme professeur dans une école de jeunes filles. Ernest, en attendant, est instruit au petit séminaire de sa ville natale (aujourd'hui, lycée Joseph Savina). Les appréciations de ses maîtres le décrivent comme « docile, patient, appliqué, soigneux ». Les prêtres lui donnaient une solide éducation en mathématiques et en latin, sa mère la complète.
En 1838, Renan remporte tous les prix au séminaire de Tréguier. Sa sœur parle de lui pendant l'été au directeur de l'école parisienne où elle enseigne et il en parle lui-même à l'abbé Félix Dupanloup, qui a créé le séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, une école où les jeunes aristocrates catholiques et les élèves les plus doués des séminaires doivent être instruits ensemble, afin de renforcer le lien entre l'aristocratie et le clergé. Dupanloup fait donc venir Renan, qui n'a que quinze ans et n'a jamais quitté la Bretagne. « J'appris avec étonnement qu'il y avait des laïcs sérieux et savants (…) les mots talents, éclat, réputation eurent pour moi un sens. » Cependant la religion lui paraît complètement différente à Tréguier et à Paris. Le catholicisme superficiel, brillant, pseudo-scientifique de la capitale, n'arrive pas à satisfaire ce garçon qui a reçu de ses maîtres bretons une foi austère.
En 1840, Renan quitte Saint-Nicolas-du-Chardonnet pour poursuivre ses études de philosophie au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Il entre rempli de passion pour la scolastique catholique car il est las de la rhétorique de Saint-Nicolas et il espère satisfaire son intelligence sérieuse avec le vaste matériel que lui offre la théologie catholique. Parmi les philosophes Reid et Malebranche l'attirent tout de suite et, après eux, il se tourne vers Hegel, Kant et Herder. C'est alors qu'il commence à voir une contradiction essentielle entre la métaphysique qu'il étudie et la foi qu'il professe, mais un goût pour les vérités vérifiables retient son scepticisme. Il écrit à Henriette que la philosophie ne satisfait qu'à moitié sa faim de vérité ; il se sent attiré par les mathématiques. Sa sœur a accepté dans la famille du comte Zamoyski, noble polonais, un poste de préceptrice qui l'oblige à séjourner en Pologne à Varsovie et à la campagne, éloignée de la France pour des années. C'est Henriette qui exerce l'influence la plus forte sur son frère, et les lettres d'elles qui ont été publiées indiquent un esprit presque égal à celui de son frère, en même temps qu'elle lui est moralement supérieure.
Ce n'est pas la philosophie mais la philologie qui finalement éveille le doute chez Renan. Ses études terminées à Issy, il entre au séminaire Saint-Sulpice pour étudier les textes bibliques avant de prendre les ordres et commencer à apprendre l'hébreu. L'un de ses maîtres est l'abbé Arthur-Marie Le Hir, auquel il rend hommage dans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Renan constate à cette époque que la deuxième partie d'Isaïe diffère de la première non seulement quant au style, mais également quant à la date, que la grammaire et l'histoire du Pentateuque sont postérieures à l'époque de Moïse et que le livre de Daniel est manifestement apocryphe. Intellectuellement Renan se sent détaché de la croyance catholique, même si sa sensibilité l'y maintient toujours. La lutte entre vocation et conviction est gagnée par la conviction. Le 6 octobre 1845, Renan quitte Saint-Sulpice pour devenir surveillant au collège Stanislas, dirigé par le Père Joseph Gratry. Mais cette solution impliquant « une profession extérieure avouée de cléricature », il préfère briser le dernier lien qui le retient à la vie religieuse et il entre à la pension privée de M. Crouzet « comme répétiteur au pair, c'est-à-dire, selon le langage du quartier latin d'alors, sans appointements. (Il avait) une petite chambre, la table avec les élèves, à peine deux heures par jour occupées, beaucoup de temps par conséquent pour travailler. Cela (le) satisfaisait pleinement. »
Renan, malgré son éducation par des prêtres, doit accepter pleinement l'idéal scientifique. La splendeur du cosmos est pour lui un ravissement. À la fin de sa vie, il écrira au sujet d'Amiel, « l'homme qui a le temps de tenir un journal intime n'a jamais compris l'immensité de l'univers. » Les certitudes de la physique et des sciences naturelles sont révélées à Renan en 1846 par le futur chimiste Marcellin Berthelot, alors âgé de dix-huit ans, et qui est son élève à la pension de M. Crouzet. Leur amitié se poursuivra jusqu'à la mort de Renan et est marquée par une intensive correspondance. Très proches, ils suivront ensemble les cours de sanskrit Burnouf au Collège de France et Berthelot l'invite régulièrement dans sa maison de famille à Rochecorbon, le domaine Montguerre. Dans cette atmosphère favorable Renan continue ses recherches en philologie sémitique et, en 1847, il obtient le prix de Volney, une des principales récompenses décernées par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour le manuscrit de son « Histoire Générale des langues sémitiques ». En 1847, il est reçu premier à l'agrégation de philosophie et nommé professeur au lycée de Vendôme.
En 1856, il épouse Cornélie Scheffer, fille d'Henry Scheffer et nièce d’Ary Scheffer. Cette alliance avec une famille protestante de peintres lui ouvre les portes du milieu artistique. De 1860 à 1861, il effectue à l'occasion de l'expédition française une mission archéologique au Liban et en Syrie. Il séjourne avec son épouse Cornélie et sa sœur Henriette dans la demeure de Zakhia Chalhoub el-Kallab et son fils Abdallah Zakhia el Kallab, famille de notables maronites d'Amchit (région de Byblos) dont les ancêtres ont été anoblis par le Sultan ottoman et ayant fondé le premier hôpital au Liban (hôpital Saint-Michel d'Amchit). Sur une plaque accrochée au mur de la demeure, il est écrit que c'est également à Amchit que Renan a trouvé la sérénité et l'inspiration nécessaires pour écrire l'une de ses œuvres majeures : La Vie de Jésus. C'est ici aussi qu'Henriette, morte en 1861, repose dans le caveau de la famille Zakhia, « tout près de l'église de ce village qu'elle a tant aimée ».
Renan n'est pas seulement un érudit. En étudiant saint Paul ou les apôtres, il montre combien il est soucieux d'une vie sociale plus développée, quel est son sens de la fraternité, et combien revit en lui le sentiment démocratique qui avait inspiré L'Avenir de la science. En 1869, il se présente à Meaux en tant que candidat de l'opposition libérale aux élections législatives. Tandis que son tempérament est devenu moins aristocratique, son libéralisme a évolué vers la tolérance. À la veille de sa dissolution, Renan est presque prêt à accepter l'Empire et, s'il avait été élu au Corps législatif, il aurait rejoint le groupe libéral des bonapartistes. Un an après éclate la guerre franco-allemande, l'Empire tombe et Napoléon III part pour l'exil. La guerre franco-allemande est un moment charnière dans l'histoire intellectuelle de Renan. Pour lui, l'Allemagne a toujours été l'asile de la pensée et de la science désintéressée. Maintenant, il voit le pays qui jusque-là représentait son idéal, détruire et ruiner la terre où il est né ; il ne voit plus l'Allemand comme un prêtre, mais comme un envahisseur.
Dans La Réforme intellectuelle et morale (1871), Renan cherche à sauvegarder l'avenir de la France. Pourtant il reste sous l'influence de l'Allemagne. L'idéal et la discipline qu'il propose à son pays vaincu étant ceux du vainqueur : une société féodale, un gouvernement monarchique, une élite et le reste de la nation n'existant que pour la faire vivre et la nourrir ; un idéal d'honneur et de devoirs imposé par un petit nombre à une multitude récalcitrante ou soumise. Les erreurs de la Commune confirment Renan dans cette réaction. En même temps, l'ironie reste toujours perceptible dans son travail mais devient plus amère. Ses Dialogues philosophiques, écrit en 1871, son Ecclésiaste (1882) et son Antéchrist (1876) (le quatrième volume des Origines du Christianisme, traitant du règne de Néron) relèvent d'un génie littéraire incomparable, mais révèlent un caractère désabusé et sceptique. Après avoir en vain essayé de faire suivre à son pays ses préceptes, il se résigne à observer sa dérive vers la perdition. Mais la suite des événements lui montre, au contraire, une France qui, chaque jour, redevient un peu plus forte. Ce qui le réveille de son incrédulité, de son attitude désillusionnée, pour observer avec intérêt la lutte pour la justice et pour la liberté d'une société démocratique. Son esprit est le plus large de son temps. Les cinquième et sixième volumes des Origines du Christianisme (L'Église Chrétienne et Marc-Aurèle) le montrent ainsi réconcilié avec la démocratie, confiant dans l'ascension graduelle de l'Homme, conscient que les catastrophes les plus grandes n'interrompent pas vraiment le progrès du monde, imperceptible mais sûr. Il s'est réconcilié en somme sinon avec les dogmes, du moins avec les beautés morales du catholicisme et les souvenirs de son enfance pieuse.
Tombe d'Ernest Renan dans le cimetière de Montmartre.
Dans sa vieillesse, le philosophe jette un regard sur ses jeunes années. Il a presque soixante ans quand, en 1883, il publie ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse, l'ouvrage par lequel il est le plus connu à l'époque contemporaine. On y trouve cette note lyrique, ces confidences personnelles auxquelles le public attache une grande valeur chez un homme déjà célèbre. Le lecteur blasé de son temps découvre qu'il existe un monde non moins poétique, non moins primitif que celui des Origines du Christianisme et qu'il existe encore dans la mémoire des hommes sur la côte occidentale de la France. Ces souvenirs sont pénétrés de la magie celtique des vieux romans antiques tout en possédant la simplicité, le naturel et la véracité que le XIXe siècle apprécie alors si fortement. Mais son Ecclésiaste, publié quelques mois plus tôt, ses Drames philosophiques, rassemblés en 1888, donnent une image plus juste de son esprit, même s'il se révèle minutieux, critique et désabusé. Ils montrent l'attitude qu'a envers un « socialisme instinctif » un philosophe libéral par conviction, en même temps qu'aristocrate par tempérament. Nous y apprenons que Caliban (la démocratie), est une brute stupide, mais qu'une fois qu'on lui a appris à se prendre en main, il fait somme toute un dirigeant convenable ; que Prospero (le principe aristocratique, ou, si l'on veut, l'esprit) accepte de se voir déposé pour y gagner une liberté plus grande dans le monde intellectuel, puisque Caliban se révèle un policier efficace qui laisse à ses supérieurs toute liberté dans leurs recherches ; qu'Ariel (le principe religieux) acquiert un sentiment plus exact de la vie et ne renonce pas à la spiritualité sous le mauvais prétexte du changement. En effet, Ariel fleurit au service de Prospero sous le gouvernement apparent des rustres innombrables. La religion et la connaissance sont aussi impérissables que le monde qu'elles honorent. C'est ainsi que, venant du plus profond de lui-même, c'est l'idéalisme essentiel qui a vaincu chez Renan.
Renan est un grand travailleur. À l'âge de soixante ans, ayant terminé Les Origines de Christianisme, il commence son Histoire d'Israël, fondée sur une étude qui occupera toute sa vie, celle de l'Ancien Testament et du Corpus Inscriptionum Semiticarum, publié sous sa direction par l'Académie des inscriptions et belles-lettres de 1881 jusqu'à sa mort. Le premier volume de l’Histoire d'Israël parait en 1887, le troisième en 1891, les deux derniers à titre posthume. Comme histoire des faits et des théories, l'ouvrage n'est pas sans erreurs ; comme essai sur l'évolution de l'idée religieuse, il reste (malgré quelques passages moins sérieux, ironiques ou incohérents) d'une importance extraordinaire ; pour faire connaître la pensée d'Ernest Renan, c'est là où il est le plus vivant. Dans un volume qui rassemble des essais, Feuilles détachées, publié lui aussi en 1891, on retrouve la même attitude mentale, une affirmation que la piété est nécessaire, tout en étant indépendante des dogmes.
Dans les dernières années de sa vie, Ernest Renan reçoit de nombreux honneurs et est nommé administrateur du Collège de France et Grand-Officier de la Légion d'honneur. Dans les huit dernières années du XIXe siècle paraissent deux volumes de l’Histoire d'Israël, sa correspondance avec sa sœur Henriette, ses Lettres à M. Berthelot et l’Histoire de la politique religieuse de Philippe le Bel, qu'il a écrite dans les années précédant immédiatement son mariage. De 1884 à sa mort en 1892, il passe ses vacances à Louannec, dans le manoir de Rosmapamon, demeure qu'il loue près de Perros-Guirec.
À l'affection cardiaque et rhumatismale dont il souffre depuis 1868 et qui a provoqué une enflure généralisée, se sont ajoutées dans les dernières années de sa vie les souffrances d'une maladie de la vessie et d'un zona. Au mois de juillet 1892, Renan part, bien malade, pour sa solitude de Rosmapamon où il meurt le 2 octobre 1892. Après des obsèques civiles (comme Victor Hugo et Félicité Robert de Lamennais), il est enterré au cimetière de Montmartre dans le caveau de sa belle-famille famille Scheffer, avec l'inscription Veritatem delixi, « j'ai aimé la vérité ». Une loge maçonnique est nommée en son honneur, bien que Renan n'ait jamais adhéré à la Franc-Maçonnerie, et qu'il ait été indifférent à cette dernière.
Parmi la descendance familiale d'Ernest Renan, peuvent être mentionnés le philosophe Olivier Revault d'Allonnes dont il est l'arrière-grand-père, ainsi que Ernest Psichari, dont il est le grand-père.
Ainsi, une part essentielle de son œuvre est consacrée aux religions avec par exemple son Histoire des origines du christianisme (sept volumes de 1863 à 1883, dont le premier, la Vie de Jésus, eut un grand retentissement). Ce livre qui marque les milieux intellectuels de son vivant contient la thèse, alors controversée, selon laquelle la biographie de Jésus doit être comprise comme celle de n'importe quel autre homme, et la Bible comme devant être soumise à un examen critique comme n'importe quel autre document historique. Cela déclenche des débats passionnés ainsi qu'un vif mécontentement de l'Église catholique.
Ernest Renan dans son bureau, par Auguste Renan.
Renan et la Bretagne
Renan était reconnu de son vivant, à la fois par les habitants de sa région trégorroise comme par toute la Bretagne, y compris par ses ennemis, comme un grand intellectuel breton. Il parlait le breton dans sa jeunesse et n'en perdit pas l'usage. Son intérêt pour sa Bretagne natale a été constant ; de L'Âme bretonne (1854) à son texte autobiographique Souvenirs d'enfance et de jeunesse (1883).
Les Affrontements de Tréguier (1903–1904)
Même après son décès, Ernest Renan continua à susciter de violentes controverses entre « laïques » et « cléricaux », en particulier dans sa ville natale où il avait acquis une maison, aujourd'hui devenue le musée « La maison d'Ernest Renan » de Tréguier. L'érection de sa statue sur la place du Martray, devant la cathédrale, inaugurée le 13 septembre 1903 par le Président du conseil Emile Combes en personne, fut vécue comme une véritable provocation par les catholiques qui protestèrent vigoureusement et répliquèrent par l'édification d'un « calvaire de réparation », dit aussi « calvaire de protestation », encore visible sur l'un des quais du port de Tréguier.
Nota : Voir ci-dessus le Monument élevé en 1903 sur la place principale de Tréguier en l'honneur d'Ernest Renan représenté aux côtés d'Athéna et Le « calvaire de réparation » (1904) à Tréguier
------ ¤¤¤¤¤¤ ------






Publié le 22 février 2018
UNE GRANDE DAME BRETONNE, LA DUCHESSE ERMENGARDE
par Yvon Abgrall 18 octobre 2017
Ermengarde, fille de Foulque le RECHIN Comte d’Anjou, naquit au château d’Angers en 1O67. En 1O93, elle épouse Alain VI FERGENT, Duc de Bretagne.
C’est la …Renaissance qui commencera à rabaisser la femme au statut de favorite-concubine, lui donnant pour seule fonction celui de satisfaire aux plaisirs des souverains, lui interdisant les fonctions de l’Etat.
Ermengarde, a tout pour séduire le jeune duc breton. D’une éducation raffinée, elle brillera par son intelligence très éveillée sur toutes choses concernant son peuple, les affaires de son Duché. L’historien Pitre-Chevalier, se basant sur des écrits de son époque, la décrit ainsi :
« Elle était de taille très déliée, elle avait le teint fort blanc, diaphane, de grands yeux aussi bleus que l’azur, la bouche d’une grande finesse. La blondeur de sa chevelure ne faisait que rehausser la perfection de tout son être, que rehaussaient encore ses goûts très sûrs dans ses choix vestimentaires : l’or, les diamants brillaient dans sa coiffure, et suivant la mode de l’époque, sur sa gorge nue, d’autres bijoux jetaient leurs éclats ».
Un autre historien, Albert Le Grand, la loue ainsi :
« Bien qu’elle fit profession de piété, elle n’avait rien qui ne répondit à la dignité qu’elle occupait, et ses penchants pour les biens qui rehaussaient la beauté de la femme n’altéraient point le soucis qu’elle avait dans l’exercice des vertus chrétiennes et de justice ».
Alain FERGENT, ne s’y trompa pas : son épouse avait l’autorité pour gouverner son duché, et il fit comprendre à sa cour et aux seigneurs bretons qu’elle prendrait une part entière à son gouvernement. Nous sommes en 1095, Alain FERGENT entend répondre à l’appel pressant du Pape Urbain II pour partir en croisade, afin de délivrer la Terre Sainte, le tombeau du Christ, mais aussi secourir et protéger les chrétiens sans cesse persécutés et massacrés s’ils ne se convertissent pas à l’islam. C’est à cette occasion que le duc breton reçoit des mains du Pape l’étendard à croix noire, le fameux Kroaz Du qui deviendra le drapeau historique breton, bien avant donc le drapeau actuel, moderne, le Gwenn ha Du. Alain FERGENT, avec ses chevaliers bretons sera, dit-on, le premier à entrer dans Jérusalem délivrée. Il fera hisser la Croix Noire au sommet de la coupole dorée de la mosquée Al-Aqsa et y fera célébrer une messe d’action de grâce pour la victoire. On dira alors des croisés bretons : « qu’ils guerroient dans l’armée chrétienne et font merveilles d’armes en Orient ». Alain FERGENT est ainsi absent de son duché, cinq longues années, et c’est donc Ermengarde qui gère les affaires du pays. Le souci du gouvernement n’empêche pas la Duchesse de veiller à l’éducation de ses fils, Conan et Geoffroy, qu’elle confie au savant maître Guillaume qui instruisit leur père.
L’historien Guy-Alexis Lobineau, écrira :
« Nous ne formerons que des jugements favorables des talents que le Duc Alain FERGENT avait reconnus dans Ermengarde à qui il confia pendant cette longue absence de la Croisade, la conduite de ses Etats, aussi bien que l’éducation de ses enfants. En effet, la Bretagne fut en paix pendant l’absence d’Alain FERGENT et la Duchesse occupée du Gouvernement n’en donna pas moins d’attention à inspirer à ses enfants la même foi dont elle était animée ».
UNE FEMME EN AVANCE SUR SON TEMPS
En juin 1101, Alain FERGENT est de retour au pays, il ramène d’insignes reliques dont une parcelle de la Vraie Croix, elles seront portées en grande solennité à l’église du Sauveur, à Lohéac. Le Duc retrouve son Duché admirablement en ordre, et ne peux que louer l’administration de son épouse. Ermengarde est une femme en avance sur son temps. Durant l’absence de son mari, elle entreprend de profondes réformes sociales. Parmi elles, nous citerons : la liberté des villageois de se marier librement, d’acheter et de revendre des terres, la suppression des « corvées » qui ne sont plus que quelques journées de travail (rappelons que depuis l’an 950, Alain BARBE-TORTE avait aboli le servage, alors que dans le Royaume de France il sévira jusqu’au XIIIe siècle), la faculté de faire appel à l’arbitrage du Duc contre leur seigneur en cas d’abus d’autorité. Un service militaire sur le lieu même où ils habitent fait obligation aux villageois de se mettre au service de leur seigneur s’il est attaqué ; la suppression du « droit de bris » qui dépouillait les naufragés en faveur du seigneur du littoral sur lequel ils avaient échoués, suppression encore de la coutume de s’approprier les biens, les terres des roturiers morts sans enfants. C’est donc tout ce train de lois sociales, dont le pivot est la charité jointe à la justice qui va faire des Bretons un peuple heureux et prospère. Ce constat est tellement évident, que le Père abbé Geoffroy du monastère de la Trinité de Vendôme écrit à la Duchesse :
« Madame, ce que j’ai entendu dire de vous, Princesse de race royale, ne m’est point désagréable. J’apprends que dans le gouvernement temporel vous suivez exactement les lois de justice. Vous faites fleurir la paix dans vos Etats. Vous faites du bien à tous, vous nourrissez les pauvres, vous étanchez la soif de ceux qui sont tourmentés, vous donnez des habits à ceux qui sont nus, vous essuyez les larmes de tous les affligés qui ont recours à vous, et l’on ne voit personne sortir mécontent de votre présence »
FLEUR DE BEAUTE PLEINE DE SAVOIR
« Fleur de beauté pleine de savoir », c’est ainsi que ses contemporains l’appellerons, tant Ermengarde est lettrée.
Elle se rend au Mont Saint- Michel, dont la bibliothèque est d’une richesse inouïe et est tenue par Robert de Thorigny, où elle peut admirer le travail des Bénédictins miniaturistes et lettristes. Ces grandes qualités et vertus attirent également l’attention du plus puissant esprit de son époque, Bernard de Clervaux, le futur Saint Bernard, promoteur d’un christianisme viril, arbitre d’une Europe qui se disait vraiment chrétienne, car il était impensable qu’il en fût autrement. Une édifiante et rayonnante correspondance naît entre l’illustre moine bénédictin et la Duchesse de Bretagne :
«Votre joie fait ma joie, et votre allégresse communicative tient mon esprit en sécurité. Sainte allégresse née en vous de l’Esprit Saint ».
On dira encore d’elle :
« Cette Dame était de même humeur que son Epoux, le Duc Alain FERGENT de Bretagne, adonnée à la piété, justice et exercice de vertus. C’était la vraie Mère de son peuple, le refuge des affligés, le modèle et exemple de toute vertu »
En 1112, lors d’un voyage à Redon, Alain FERGENT tombe gravement malade. On le porte au monastère. Désireux de finir sa vie dans la prière, le duc abdique en faveur de son fils aîné Conan. Alain FERGENT retrouve la santé et Ermengarde, en accord avec lui, décide de se retirer au monastère de Fontevrault comme simple religieuse. En ce lieu de prières et de paix, elle n’oublie en rien de guider par ses sages conseils son fils Conan. Ermengarde apprend la mort de son fils Geoffroy tombé en Syrie alors qu’il défendait dans la grande plaine de Ninive les chrétiens encerclés par les forces musulmanes. Peu après, c’est la mort de son époux qui vient la frapper. Ermengarde quitte son couvent pour mener les funérailles solennelles d’Alain FERGENT, qui est inhumé dans le chœur de l’abbaye de Saint-Sauveur de Redon, fondée par saint Konwoion, le moine conseiller de Nominoé. Conan demande à sa mère de ne point retourner à Fontevrault, il a besoin d’elle, ses conseils sont trop précieux.
FONDATRICE D’ABBAYES PRESTIGIEUSES
Le célèbre moine encourage Ermengarde à fonder dans son duché de nombreuses abbayes, citons entres autres : Notre Dame de Bégard, Notre Dame du Relecq en Plounéour-Ménez, Notre Dame de Buzai près de Nantes, Notre Dame de Langonnet, Notre Dame de Bon-Repos, Notre Dame de Vieuxville en Epiniac, Notre Dame de Lanvaux en Grand-Champ, Notre Dame de Botgwenn (Boquen). Toutes ces abbayes seront profanées et détruites à la Révolution française. Si aujourd’hui, certaines sont partiellement restaurées, c’est uniquement dans un souci de préservation du patrimoine religieux breton, ce qui est une excellente chose, mais la finalité est profane, seul le festif touristique anime ces lieux.
L’abbaye de Boquen restaurée par Dom Alexis Presse est une exception, de même l’abbaye de Landévennec, mais dans cas, il n’y a pas eu de restauration des ruines, mais construction d’une nouvelle abbaye. Les ruines de l’antique abbaye jouxtent les bâtiments conventuels modernes. C’est le grand problème de la politique de préservation du patrimoine architectural en France, on préfère conserver les ruines, entreprendre quelques restaurations, les Bâtiments de France ont la hantise d’être accusés de faire du Viollet-le-Duc, donc du pastiche de l’ancien.
Ermengarde est aussi en relation avec le moine breton, Robert d’Arbrissel (1047-1117), grand prédicateur, et fondateur de l’abbaye de Font-Evraud (Fontevrault). Elle est aussi en correspondance avec le célèbre et controversé Abélard de Saint Gildas de Rhuys. En 1129, elle reçoit le voile des mains de Bernard de Clairvault, et fait le voyage en Palestine où son frère Foulques d’Anjou est roi de Jérusalem depuis la mort de Baudouin. Son âme ardemment religieuse est heureuse de contempler les lieux saints que son mari a contribué à délivrer du joug de l’islam. En signe d’action de grâce, elle entreprend de bâtir une église au puits de Jacob où Jésus parla à la Samaritaine. Hélas, un raid ennemi détruit le sanctuaire qui allait vers son achèvement, Ermengarde qui doit retourner en Bretagne est contrainte d’abandonner ce projet. De retour dans son Duché, elle apprend que le Prieur du Mont Saint Michel, Bernard du Bec a bâti sur l’îlot voisin de Tombelaine un prieuré et une chapelle dédiés à Notre Dame la Gisante dont le fanal éclaire chaque nuit les marins. Ermengarde dépose sur l’autel de granit breton un cœur de rubis et ses plus beaux diamants. En 1793, le Mont est profané et transformé en prison, le sanctuaire de Tombelaine est pillé, les trésors déposés par Ermengarde emportés par la soldatesque révolutionnaire, le Prieuré de Tombelaine est démoli. De nos jours, il ne reste plus que quelques murets…
Le 1er juin 1147, Ermengarde rend son âme à Dieu, son corps est déposé au côté de celui de son époux, dans l’abbaye Saint Sauveur de Redon. D’après l’historien Albert Le Grand, elle est déclarée Bienheureuse, en faisant ainsi une sainte … non reconnue par l’Eglise, contrairement à une autre Duchesse bretonne, Françoise d’Amboise (1427-1485), béatifiée par le Pape Pie IX, le 11 juillet 1863.
CE VISAGE ROYAL QU’ON VANTE AVEC TRANSPORT
Ermengarde, avait pesée de toute son autorité pour, en 1096, faire nommer évêque de Rennes, le célèbre Marbode, d’origine angevine comme elle. Il avait la charge de Maître Ecole, c’est-à-dire celle de chef suprême des Etudes, qui rivalisait avec les Universités de Paris, Chartres et Rennes. Marbode fut un des grands esprits renommés de son temps, et reconnu comme un évêque, orateur, poète, sans doute le plus grand du XIe siècle. Impressionné par la haute personnalité d’Ermengarde, il écrivit une épître qui est un portrait de la duchesse bretonne, véritable élégie louant ses vertus, mais lui rappelant avec lyrisme, tendresse et tristesse, qu’en ce monde « tout est éphémère » :
« Fille de Foulque, honneur du pays d’Armorique – Belle, candide, illustre, ingénue et pudique – Si vous n’aviez pas pris le fardeau de l’hymen – Si des fils n’étaient pas sorti de votre sein – J’aurais cru voir en vous la déesse de Cynthe. Mais rien ne remplaçant la virginité sainte – Princesse par l’hymen, princesse par le sang – Je puis à tout le moins vous mettre au premier rang des déesses qu’on vit unir leur destinées aux dieux, et contracter d’Immortels hyménées.
Parlant d’elles et peignant leur beauté – Je tracerais de vous un portrait non flatté. Mais toutes ces splendeurs dont la femme est si fière, passerons comme l’ombre et deviendrons poussière – Ou si votre destin doit prolonger son cours, si vous devez compter sur d’innombrables jours – Subissant des horreurs presqu’à la mort pareilles –Vous-même serez mise au nombre des vieilles.
Ce visage royal qu’on vante avec transport – Qu’on vante avec raison, la vieillesse ou la mort – Le flétriront ; ces yeux au regard vif et tendre – Et ces longs cheveux blonds se réduiront en cendres. On dit que votre esprit éloquent et subtil – Ne connaît point d’égal. Et qu’en restera-t-il ? Ce qui peut en rester de mieux : la renommée : c’est-à-dire du son, du vent, de la fumée.
La mite sait ronger les tissus de drap d’or – Et le voleur ravir diamants et trésors – Le sage prise peu ces choses périssables _ Vos rideaux empourprés font-ils plus délectables – Des nuits que vient troubler la crainte du trépas ? – Le vers prennent leur part de vos riches repas. Valets, femmes, châteaux, donjons et forteresses, a la mort, il faudra de toutes ces richesses – Se séparer, Comtesse, au-delà du tombeau – Que vaudront votre titre et le royal bandeau – Et le manteau ducal fourré de blanches hermines – Et vos gardes d’honneur, gens de si bonne mine ?
Faut-il énumérer tous les trésors divers – Qu’accumulent pour vous et la terre et les mers ? A tous ces biens, Madame, il manque la durée – Mais votre âme dévote à Jésus consacrée – Des pauvres vous faisant le pain, le vêtement – Voilà, pour l’œil de Dieu, votre bel ornement – Voilà votre trésor, voilà votre richesse – Que ne détruiront point la mort, ni la vieillesse »
Dans l’ article sur Lady Mond, nous avions fait le rapprochement entre cette grande Dame du XXe siècle et Ermengarde, soulignant combien il y avait entre elles des points communs : la foi, la charité, le goût de la beauté des choses, un esprit avide de connaissances. Toutes deux surent mettre leur réussite, leur fortune au service des plus humbles, toutes deux eurent le souci de leur peuple. Toute deux surent, car leur foi guidée par de grands esprits le leur rappelait, que toute chose passe comme le chante si intensément notre beau cantique des trépassés Tremen ‘ra pep tra :
«Selaou, va breur ker – Buan ‘red an amzer – Tremen ‘ra pep tra – Nerz, madou, yec’hed, yaouankiz ha gened – Tremen ‘ra pep tra »
«Ecoute, mon cher frère – Le temps court vite- Toute chose passe –Force biens, santé, jeunesse et beauté ».
C’est bien ce que chante, et lui rappelle dans son poème l’évêque Marbod.
------ ¤¤¤¤¤¤ ------
Des clichés caricaturaux nous ont présentés, et nous présentent toujours, la femme du Moyen-Age comme étant illettrée, soumise, passant son temps à soupirer, tout en faisant des points de tapisserie, après son époux parti guerroyer, guettant son retour façon « sœur Anne, ma sœur Anne, ne voie-tu rien venir ? ».
Or nous savons par des historiens sérieux, comme Régine Pernoux, Jean Sévillia et bien d’autres, que durant ce long Moyen-Age tant décrié comme un temps d’obscurantisme, la femme avait un statut qui faisait d’elle un être reconnu et respecté. C’est la …Renaissance qui commencera à rabaisser la femme au statut de favorite-concubine, lui donnant pour seule fonction celui de satisfaire aux plaisirs des souverains, lui interdisant les fonctions de l’Etat.
Ermengarde, a tout pour séduire le jeune duc breton. D’une éducation raffinée, elle brillera par son intelligence très éveillée sur toutes choses concernant son peuple, les affaires de son Duché. L’historien Pitre-Chevalier, se basant sur des écrits de son époque, la décrit ainsi :
Des clichés caricaturaux nous ont présentés, et nous présentent toujours, la femme du Moyen-Age comme étant illettrée, soumise, passant son temps à soupirer, tout en faisant des points de tapisserie, après son époux parti guerroyer, guettant son retour façon « sœur Anne, ma sœur Anne, ne voie-tu rien venir ? ».
Or nous savons par des historiens sérieux, comme Régine Pernoux, Jean Sévillia et bien d’autres, que durant ce long Moyen-Age tant décrié comme un temps d’obscurantisme, la femme avait un statut qui faisait d’elle un être reconnu et respecté.



Publié le 4 juillet 2018
Lady Mond, une Bretonne
devenue l'une des plus riches du monde
Durant la Belle Époque, Marie-Louise Le Manac’h, alias Maï, a connu un destin peu ordinaire, de Belle-Isle-en-Terre jusqu’aux palaces parisiens et londoniens où elle rencontre Robert Mond, surnommé le roi du nickel. Maï la Bretonne devient, en 1922, Lady Mond, l’une des femmes les plus riches du monde. Récit d'une vie épique.
Nul n’aurait pu prévoir le destin de la petite Marie-Louise « Maï » Le Manac’h, née le 6 février 1869 au moulin de Prat-Guéguen, dans la commune de Belle-Isle-en-Terre, près de Guingamp. Elle est la sixième enfant d’une fratrie qui en comptera dix et la seule fille. De quoi forger un caractère qui se révélera bien trempé… À la maison, on ne parle que breton et la petite Maï apprend le français à l’école des filles où elle est bien notée. Son père est meunier, la famille est modeste, mais ils s’entendent bien avec le propriétaire du moulin qui propose à Maï, en juin 1885, de visiter Paris. La jeune fille découvre la ville lumière et assiste aux funérailles nationales de Victor Hugo.
Maï à 20 ans, son mari "le roi du nickel", Maï à 40 ans
Inculpée pour outrage à la pudeur
Maï Le Manac’h est une adolescente que les garçons remarquent, mais que ses origines modestes empêchent de décrocher un beau parti. En 1886, elle disparaît et quitte les rives du Léguer pour Guingamp et Saint-Brieuc, où elle aurait travaillé à l’hôtel de la Croix-Rouge. Rapidement, elle rejoint Paris où elle semble vivre une vie de bohème, fréquentant les artistes de Montparnasse et des milieux parfois interlopes. Ces années restent mystérieuses. On sait qu’elle est inculpée, en 1893, pour outrage à la pudeur. On l’accuse de s’être exhibée, nue, au restaurant Lemardelay. Quelque temps plus tard, Maï s’installe à Londres où elle épouse un marchand de fruits et légumes, Simon Guggenheim, d’origine alsacienne. Il décède de maladie en décembre 1900.
Maîtresse de l'infant d'Espagne
Depuis son installation à Londres, Maï semble avoir une vie mondaine assez remplie, mais une rencontre la fait entrer dans le « grand monde ». En 1900, à l’hôtel Savoy, la jeune veuve est présentée à l’infant d’Espagne, Antoine d’Orléans, duc de Galliera. Dépensier et volage, ce prince est séparé de sa femme, Eulalie d’Espagne, qui a demandé le divorce. Il tombe amoureux de la jeune Bretonne qui sera sa maîtresse jusqu’en 1906. Le couple mène grand train entre Londres, Paris et Séville. Elle rencontre même en audience privée le pape Pie X. Leur relation amoureuse s’étale au grand jour, mais le naturel revient au galop et Antoine d’Orléans finit par se lasser et tromper Maï. Furieuse d’être éconduite, elle lui casse plusieurs dents d’un coup d’ombrelle !
Le roi du nickel
Revenue vivre à Londres, Maï Le Manac’h fait la connaissance, en 1910, de Robert Mond. Surnommé le roi du nickel, il a découvert un nouveau procédé pour produire ce métal. Il emploie des milliers de personnes en Grande-Bretagne, au Canada et dans le monde. Il est aussi collectionneur d’art, égyptologue et mécène. Il tombe amoureux de Maï qu’il épouse en 1922. Cette liaison fait de Maï l’une des femmes les plus fortunées du monde !
Le couple mène dès lors une vie mondaine des deux côtés de la Manche. Comme nombre de Britanniques, ils achètent une résidence à Dinard, le château du Bec, dans l’embouchure de la Rance. En 1928, son nom est bretonnisé en Castel-Mond, décoré de toiles de Rembrandt, Watteau et de nombreux chefs-d’œuvre. Ils en font leur résidence principale, mais partagent également une partie de leur temps avec Belle-Isle-en-Terre. Robert Mond offre, en effet, le château de Coat-an-Noz à sa femme pour ses soixante ans, une superbe demeure avec tout le confort moderne.
Lady Mond revient volontiers au pays. Elle encourage l’un de ses frères à se faire élire maire de Belle-Isle-en-Terre. Elle finance la construction de nombreux bâtiments publics, comme une mairie, une poste, un haras, la salle des fêtes. Lady Mond se montre très généreuse pour son pays d’origine. Elle apporte son soutien à de nombreuses initiatives culturelles et exprime un fort attachement à ses racines bretonnes. Elle devient ainsi membre du Gorsed de Bretagne avec le titre de « bardesse d’honneur » et fréquente de nombreux intellectuels bretons. De son adolescence, elle a également conservé le goût pour le gouren (lutte bretonne). Le château de Coat-an-Noz accueille des tournois dans les années 1930 et elle siège, avec son frère, Job Manac’h, au bureau de la Falsab, la fédération des jeux athlétiques bretons.
Élevé au titre de chevalier en 1932, Sir Robert Mond décède en 1938, laissant un joli héritage à sa veuve. En raison de ses liens avec la Grande-Bretagne, Lady Mond est inquiétée par les Allemands qui réquisitionnent Coat-an-Noz et Castel-Mond à Dinard.
C’est dans son château du bourg de Belle-Isle-en-Terre qu’elle s’installe alors et où prendra fin son étonnante destinée, le 21 novembre 1949.
Plusieurs lieux conservent son souvenir
Issue d’une famille de meuniers, Maï Le Manac’h aura vécu une vie parmi les princes sans oublier d’où elle venait… Devenue très riche, elle ne délaisse pas Belle-Isle-en-Terre où plusieurs lieux conservent son souvenir. Longtemps abandonné, le château de Coat-an-Noz (« La forêt de la nuit », photo), près du joli bourg de Loc-Envel, est en cours de restauration.
En 1932, pour se rapprocher des siens, elle demande à l’architecte Hénar de Saint-Malo d’édifier un château de granit dans le bourg. Il comporte quatre niveaux, avec douze fenêtres pour chacun d’entre-deux. Mais, une fois achevé, elle s’aperçoit qu’il est trop proche de la route et cache la mairie. Elle le fait donc reconstruire… dix mètres plus loin. En 1932 toujours, elle fait raser le moulin Toulquer, dernière résidence de ses parents, pour y construire le pavillon Mond, devenu aujourd’hui la mairie et la salle des fêtes. À côté de celle de Locmaria, les Mond font bâtir une chapelle personnelle, disposant d’une crypte d’inspiration égyptienne et décorée de marbre de Carrare. Elle constitue le mausolée de Lady Mond où elle repose dans un tombeau de granit rose.
------ ****** ------






Publié le 3 février 2020
Yves COPPENS
Yves COPPENS en 2006.
Yves COPPENS, né le 9 août 1934 à Vannes (Morbihan), est :
Son nom est attaché en France à la découverte, en 1974 en Éthiopie, du fossile d'Australopithèque surnommé Lucy, en tant que codirecteur de l'équipe qui l'a mis au jour, avec l'Américain Donald JOHANSON et le Français Maurice TAIEB.
Famille
Son père, le physicien René COPPENS, lui-même chevalier de la Légion d'honneur, a travaillé sur la radioactivité des roches et a rédigé de nombreuses notes scientifiques pour l’Académie des sciences. Il fut professeur à la faculté des sciences et à l'École nationale supérieure de géologie de Nancy ; il est inhumé à Vandœuvre-lès-Nancy. Sa mère fut une pianiste concertiste.
Études
Yves COPPENS est passionné par la préhistoire et l'archéologie depuis son enfance, fasciné par exemple par les alignements de mégalithes de Carnac, non loin de sa ville natale de Vannes ; il a commencé très tôt à participer à des travaux de fouille et de prospection en Bretagne. Il obtient un baccalauréat en sciences expérimentales au lycée Jules Simon de Vannes puis une licence en sciences naturelles à la faculté des sciences de l'université de Rennes. Il prépare un doctorat sur les proboscidiens au laboratoire de Jean PIVETEAU à la faculté des sciences de l'université de Paris (la Sorbonne).
Carrière
En 1956, il devient attaché de recherche du Centre national de la recherche scientifique alors qu'il n'a que 22 ans. Il se dirige vers l'étude des époques quaternaire et tertiaire. En 1959, chercheur dans le laboratoire de l'Institut de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle sous la direction de René LAVOCAT, ce dernier lui confie la détermination des dents de proboscidiens (sur lesquels porte sa thèse) du pliocène issus de fossiles de vertébrés trouvés par des géologues en Afrique. Ce contact avec des géologues lui permet de partir dès janvier 1960 en Afrique, et par la suite de monter des expéditions au Tchad, en Éthiopie, puis en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Indonésie et aux Philippines.
Il devient maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle en 1969, puis sous-directeur au Musée de l'Homme.
Yves COPPENS est nommé directeur et professeur au Muséum national d'histoire naturelle en 1980, ainsi que directeur d'étude à l'École pratique des hautes études. Il est élu à la chaire de paléontologie et préhistoire au Collège de France en 1983, chaire qu'il occupe jusqu'en 2005, date à laquelle il devient professeur honoraire.
En 2002, il est nommé à la présidence d'une commission particulière (dite « commission COPPENS ») dont les travaux ont servi de base à l'élaboration de la Charte de l'environnement, texte préparé par le secrétariat général du gouvernement et par le cabinet du président de la République et qui a été soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2004 et intégré en 2005, par la loi constitutionnelle du 1er mars, dans le bloc de constitutionnalité du droit français, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
En 2006, il est nommé au Haut Conseil de la science et de la technologie par Jacques Chirac.
En janvier 2010, il est nommé président du conseil scientifique chargé de la conservation de la grotte de Lascaux par Nicolas Sarkozy.
Le 13 avril 2016, il est nommé conservateur du Manoir de KERAZAN par l'Institut de France.
Yves COPPENS est présent dans de nombreuses instances nationales et internationales gérant les disciplines de sa compétence. Il a dirigé en outre un laboratoire associé au CNRS, le Centre de Recherches Anthropologiques - Musée de l'Homme, et deux collections d'ouvrages du CNRS, les Cahiers de paléoanthropologie et les Travaux de paléoanthropologie est-africaine.
Membre d'académies
Yves COPPENS est membre de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, de l'Académie des Sciences d'Outremer et de l'Academia Europaea, de l'Académie royale des sciences Hassan II du Maroc, de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines de Côte d'Ivoire, membre honoraire de l'Academia de Medicina de Sao-Paulo, membre associé de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, correspondant de l'Académie royale de médecine de Belgique, Honorary fellow du Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Foreign associate de la Royal Society d'Afrique du Sud et docteur honoris causa des universités de Bologne, de Liège, de Mons et de Chicago. Il est également membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
En 1998, il est candidat malheureux à l'Académie française.
Le 18 octobre 2014 il est nommé membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences par le pape François.
En octobre 2015, la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, a retenu Yves COPPENS pour le Nouveau Prix de Rome à la villa Médicis à Rome.
Découvertes notables
En 1961, il récupère un crâne fossile d'hominidé trouvé près de Yaho (falaise d'Angamma), dans le nord du Tchad, qu'il nomme en 1965 Tchadanthropus uxoris, en hommage au Tchad et à son épouse, qui l'a reçu du découvreur autochtone en cadeau. D'un âge controversé, ce fossile ne suscite toujours pas de consensus scientifique après plus d'un demi-siècle.
En 1967, il part en expédition avec Camille ARAMBOURG dans la vallée de l'Omo, au sud de l'Éthiopie. Ils découvrent à Shungura, à l'ouest de l'Omo, le premier spécimen fossile de l'espèce Paranthropus aethiopicus, une mandibule édentée datée de 2,6 millions d'années, qui devient l'holotype de son espèce. D'autres fossiles de la même espèce sont ensuite découverts dans la même région.
Le 30 novembre 1974 à Hadar, dans la basse vallée de l'Awash, un fossile complet à 40 % d'Australopithecus afarensis est découvert dans le cadre de l'International Afar Research Expedition, un projet regroupant une trentaine de chercheurs éthiopiens, américains, et français, codirigé par Donald JOHANSON (paléoanthropologie), Maurice TAIEB (géologie), et Yves COPPENS (paléontologie). Le premier fragment du fossile a été repéré par Donald JOHANSON et Tom GRAY, l'un de ses étudiants. Le fossile est surnommé « Lucy », en référence à Lucy in the Sky with Diamonds, la chanson des Beatles écoutée par l'équipe à cette époque.
Origine de l'homme moderne
Pour la plupart des chercheurs, Homo sapiens est apparu en Afrique il y a désormais environ 300 000 ans, et s'est répandu il y a environ 60 000 ans vers les autres continents. Cette théorie est connue du grand public sous le nom anglais d'Out of Africa, et sur le plan scientifique sous le nom d'« hypothèse d'une origine unique récente », « hypothèse du remplacement », ou modèle de l'« origine africaine récente ». Yves COPPENS, parmi d'autres chercheurs, ne croyait pas à la seule origine africaine d'Homo sapiens et défendait depuis les années 1980 la théorie multirégionale ou « théorie de continuité avec hybridation ». Selon cette théorie, qu'Yves COPPENS aimait nommer « Out of nowhere », le passage des espèces archaïques d'Homo à Homo sapiens se serait fait parallèlement dans toutes les régions de l'ancien monde, sauf dans un certain nombre de régions particulièrement isolées, notamment en Europe où Homo heidelbergensis n'a pas évolué en Homo sapiens mais aurait donné naissance à l'Homme de Néandertal. Par la suite, selon lui, il y aurait sans doute eu un « grand métissage » entre les Homo sapiens venus d'Afrique et les autres espèces d'Homo se trouvant sur place.
En 2014, Yves COPPENS a admis que, s'il avait mis en doute un certain temps la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, parce qu'il le voyait naître ailleurs, il « pense aujourd'hui qu'il y a de bons arguments pour la situer en effet bel et bien autour de 100 000 ans ». Ensuite, Homo sapiens va s'installer en Europe, en Asie, et en Australie vers 50 000 ans, en s'hybridant selon lui avec les populations humaines antérieures, puis en Amérique et dans les petites iles d'Océanie qui étaient encore vierges de toute population humaine.
La Bretagne peut être fière qu’un de ses fils soit ainsi reconnu par le monde entier !
------ ****** ------








Publié le 3 février 2020
Qui sont les 7 bretons les plus influents au monde ?
Si pour certains sociologues, un habitant de Paris sur dix serait d’origine bretonne, il n’en demeure pas moins que notre « Mafia Bretonne » continue admirablement de s’exporter dans n’importe quel domaine et n’importe quelle région. Et pour vous le prouver : on a cherché le top 7 des bretons les plus influents au monde.
1- FRANÇOIS PINAULT OU LE GWENN HA DU À VENISE
François Pinault, né le 21 août 1936 aux Champs-Géraux (Côtes-d'Armor), est un homme d'affaires, fondateur des sociétés Artémis et Kering (anciennement PPR).
Grâce à lui le drapeau breton flotte sur Venise et plus spécifiquement sur le palais Grassi, musée d’art contemporain. S’il était déjà connu comme étant le propriétaire du Stade Rennais, Pinault s’affirme comme un breton (un vrai) au cours de l’inauguration du musée, durant laquelle il affirme fièrement : « La Bretagne m’a tout appris : le goût de l’effort, la nécessité d’investir de nouveaux territoires… ».
2- LE CLAN BOLLORÉ, SOIRÉE CELTIQUE ASSURÉE
Vincent Bolloré, né le 1er avril 1952 à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine) a débuté en 1970 dans la banque.
En 1981, il reprend avec son frère Michel-Yves Bolloré les papeteries familiales (dont la marque la plus connue est OCB), alors en grande difficulté, et la sort de sa tradition papetière en la recentrant sur les sachets à thé, les papiers ultrafins,
Lors d’une soirée d’automne à Puteaux, mi-novembre 2009, Vincent Bolloré (PDG du groupe Bolloré et président d’Havas, 6ème groupe mondial de communication et un des bretons les plus influents au monde) reçoit. Le noir et blanc du drapeau breton s’impose partout sur les tables comme sur les murs. Vincent Bolloré est le plus allégorique des bretons tant la palette de ses activités est diversifiée.
3- LES LECLERC, LES CHEFS DE BORD DE L’INDUSTRIE BRETONNE
Michel-Edouard Leclerc né le 23 mai 1952 à Landerneau (Finistère) est le président directeur général de l'enseigne de grande distribution E. Leclerc. Il a succédé à son père Édouard Leclerc à la présidence de l'ACDLec (Association des Centres Distributeurs Leclerc) en 2006, après en avoir assuré la coprésidence pendant 17 ans.
Ce sont les industriels les mieux identifiés en tant que Bretons. Depuis près de 70 ans la chaîne Leclerc n’a cessé de parcourir les terres françaises. Leclerc ce n’est plus la petite épicerie de Landerneau mais bien 660 magasins en France sans compter les antennes en Pologne, Espagne, Portugal, Italie…
4- LES FRÈRES GUILLEMOT, LE CLAN MORBIHANNAIS DU JEU VIDÉO
Ils sont cinq frères (Claude, Michel, Yves, Gérard, Christian).
Yves, né à Carentoir (Morbihan) le 21 juillet 1960, est le PDG.
En 1986, la fratrie Guillemot, ancrée à Carentoir (Morbihan) s’impose dans le milieu du jeu vidéo, par ses déclinaisons des Lapins Crétins (plus de 20 millions d’exemplaires vendus), Prince of Persia ou Assassin’s Creed, sous un nom : Ubisoft. Elle est présente dans 55 pays, pour un chiffre d’affaires annuel en 2017 de 1 731,9 M€, ce qui en fait le numéro 3 mondial.
5- YVES ROCHER, BRETON DE NATURE
Né à La Gacilly (Morbihan) le 7 avril 1930
Fils de commerçant il fonde en 1960 à la GACILLY (Morbihan) le groupe Yves Rocher qui rassemble aujourd’hui 15 000 personnes. Aussi, fut-il maire de cette commune pendant plus de quarante ans. La GACILLY progresse dans cet objectif écologique notamment grâce à son musée végétal, son éco hôtel ou encore son festival de photographie dédié à la nature.
6- LOUIS LE DUFF, LE RÊVE AMÉRICAIN MADE IN BREIZH
Né à Cléder (Finistère) le 1er août 1946
Après des études en école de commerce (Angers), et un MBA aux États-Unis, il rentre en France en 1976 avec pour objectif de développer le fast-food. Aujourd’hui, le groupe Le Duff c’est : Brioche Dorée, Del Arte, Fournil de Pierre, Bridor, la Ferme des Loges, Bakery Bruegger’s. Il est ainsi le deuxième acteur mondial du secteur.
7- JEAN-GUY LE FLOC’H : LE RETOUR AU PAYS
Né à Carhaix le 9 novembre 1953
Collaborateur de V. Bolloré, il travaille tout d’abord au pays, puis à Paris. Ne supportant plus cette vie, il décide de revenir au pays et de reprendre l’ancienne Bonneterie d’Armor à Quimper, maison fondée en 1938 par Walter HUBACHER dont l’objectif était de produire des sous-vêtements de qualité commercialisés déjà sous la marque Armor Lux.
Voilà la liste non-exhaustive des bretons qui colportent notre culture et nos traditions par leur implication dans des industries plus variées les unes que les autres, mais aussi par l’attractivité de notre région pour les entreprises et l’entreprenariat.
Article proposé par Joséphine
Brestoise pur beurre, c’est à la pointe de l'ouest que Joséphine a développé son amour pour la Bretagne et ses traditions. Si elle s’est envolée à Paris puis à Rouen, sa condition d’expat’ lui permet de porter fièrement nos couleurs bretonnes.


